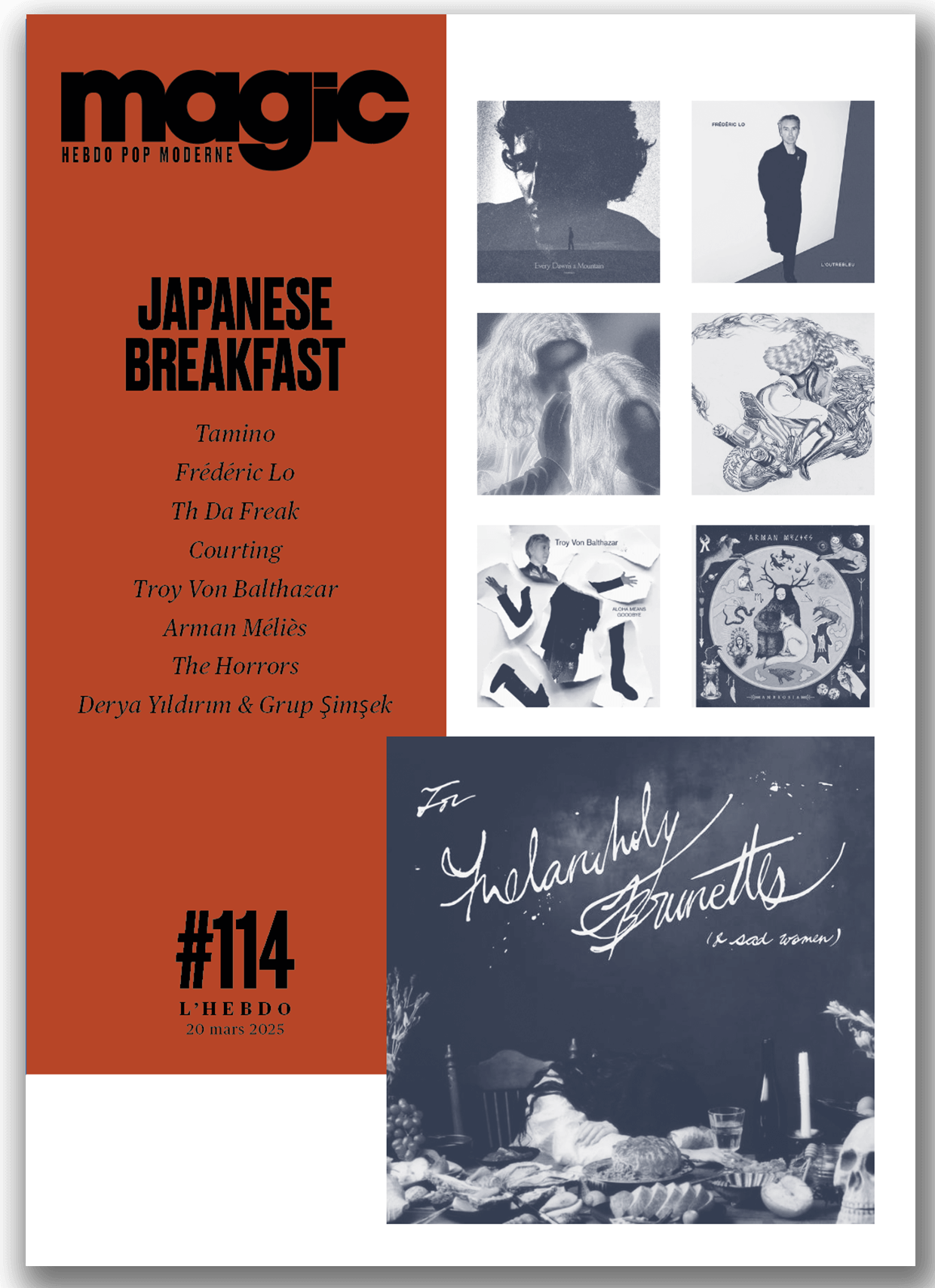Grizzly Bear revient, en détails, sur la genèse de son nouvel album Painted Ruins dans le numéro 206 de Magic. Nous publions ici la chronique de l’album, parue dans le numéro précédent.
Il y a deux façons de considérer Painted Ruins, le quatrième album de Grizzly Bear, qui va se faire désirer jusqu’au retour des vacances et qui justifie votre fébrile attente. La première consiste à considérer que le groupe de Brooklyn n’a pas vraiment remis en cause les acquis de Shields, sa précédente livraison (2012). La seconde prend acte de la capacité du quatuor co-piloté par Edward Droste et Daniel Rossen à se maintenir à ce niveau extravagant d’excellence, amplifié encore par la production de son bassiste Chris Taylor, l’une des plus puissantes et identifiables de ce temps. La variation des climats et l’inspiration des compositions confèrent à Painted Ruins le double privilège des grands disques : une efficacité quasi instantanée et une complexité qui rend compulsive la succession des écoutes. Chroniquer un Grizzly Bear est un exercice périlleux : chaque écoute enrichit la précédente, chaque zone du disque domestiquée donne une perception modifiée de l’ensemble, et ce travail de découverte en continu était encore à l’œuvre quand il a fallu imprimer ces pages et accepter que cette dynamique n’aurait peut-être jamais de fin. Les chansons de Grizzly Bear ont plusieurs personnalités et on ne sait jamais vraiment laquelle s’adresse à vous. Elles croulent sous l’opulence de vibrations d’autant plus troublantes que chaque chose est à sa place : des rythmiques subtiles comme de la dentelle, des basses musculeuses et chorégraphiques, des bourdonnements aux origines non identifiées, des torrents de chœurs, des mélodies de chant comme des lignes calligraphiées, des flashs de guitares ou de claviers tels des décharges d’adrénaline. Il arrive que le groupe donne un riff auquel raccrocher son oreille, comme toute pop song qui se respecte, mais le plus souvent cet appât initial se disloque dans un fracas sous contrôle. Les cuivres sont probablement les seuls instruments absents de Painted Ruins, même si le bouillonnement de sons dans lequel s’achèvent la plupart des morceaux rappelle les quintettes de jazz les plus créatifs et les plus habités. S’il fallait désigner les points d’ancrage du disque, il faudrait d’abord s’arrêter sur Mourning Sound. Le single sorti ce printemps rappelle que le duo basse-batterie est le point de départ de tous les orages sonores lumineux qui font la griffe du groupe. Il faudrait enchaîner sur Three Rings, qui débute par le fantasme improbable d’une rencontre entre Moondog et Radiohead, pour s’achever telle une valse vénéneuse jumelle de Sleeping Ute, le chef d’œuvre qui ouvrait Shields. Il faudrait enchaîner sur Aquarian, morceau bipolaire qui sonne comme un jam rationalisé par un gros travail de groupe, où une mélodie miraculeuse émerge aisément d’une pure apocalypse rythmique. Cut-Out est peut-être le morceau le plus accessible du disque, avec sa rythmique sautillante, son riff instantané et sa voix sinueuse. Il faut idéalement l’écouter en respectant la coulée sonore de l’album, à sa place, comme tous les titres de Painted Ruins. Car dans sa capacité à créer un son rock visionnaire, Grizzly Bear reste un groupe à l’ancienne. Il ne fait paraître ses albums qu’une fois drapés du statut d’œuvre globale et cohérente. Nostalgiques d’OK Computer, séchez vos larmes et avalez votre nostalgie. La relève est sous vos yeux.
Cédric Rouquette