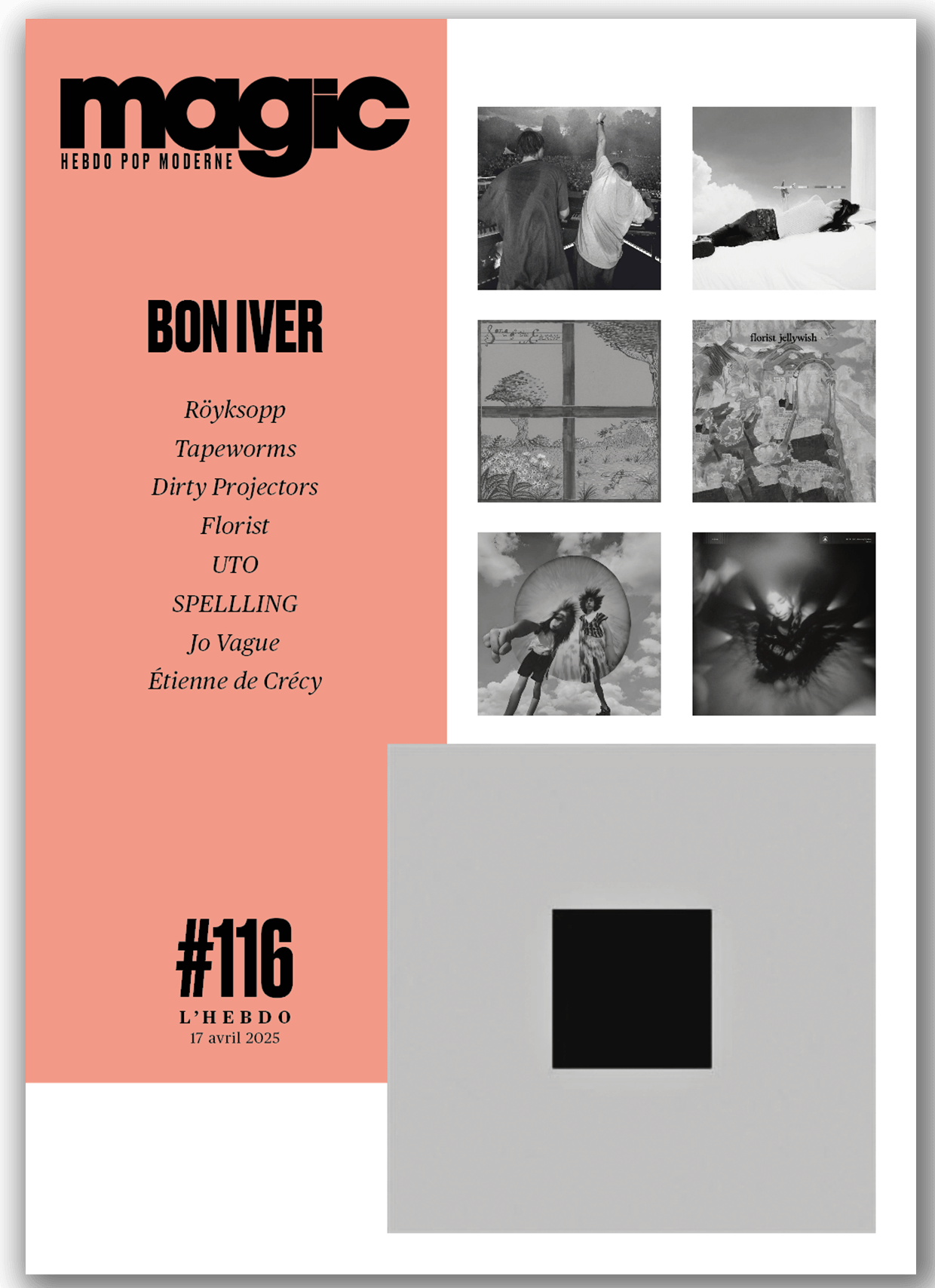Avec la réédition deluxe de 1999 de Prince, Warner Music nous donne l'occasion de revenir aux racines d'un album qui marque la période la plus créative du Kid de Minneapolis.
Il les a prévenus dès la signature de son contrat d’artiste, à l’été 1977. Il n’a alors que 19 ans quand il impose aux exécutifs de Warner ses conditions avant de signer le juteux contrat. Non seulement il obtient d’être son propre producteur, mais il les prévient explicitement : qu’on n’attende pas de lui qu’il soit un artiste étiqueté R&B. « Je ne suis pas plus R&B que rock. Je suis un artiste et mon registre est le plus large possible. Si je vous délivre des titres rock, ne venez pas me dire que c’est impossible de les sortir parce que je suis noir. »
Le cinquième album de Prince, 1999, son premier double, sort le 27 octobre 1982. Un mois plus tard, le 30 novembre, sortira Thriller de Michael Jackson. Leur point commun ? Fédérer les publics, tendre le pont entre la « race music », à laquelle le classement R&B du Billboard était spécifiquement réservé, et le Top 10, cœur de cible des rockers à bandana qui déferlaient alors sur les ondes. Un média naissant, MTV, allait les aider dans leur conquête. Grâce à ses clips en lourde rotation, Michael Jackson décrochera la lune (66 millions d’unités écoulées), Prince, une plus modeste 9ème place au Top 10 pour 1999 (4 millions d’exemplaires écoulés au États-Unis), grâce à la diffusion en boucle du clip de Little Red Corvette, ce rock chromé choisi comme second single.
Voilà pour les points communs. Car là où Thriller est le fruit d’un important travail collectif (Quincy Jones aux manettes, un casting millésimé de requins de studios made in L.A.), 1999 s’épanouit principalement en terres DIY. C’est cette rencontre au sommet d’un homme avec sa machine qu’a « coffré » Warner Music, maison de disque historique de l’artiste.
Été 1980. Prince s’est fait installer une console 16 pistes au sous-sol de la maison qu’il loue à Lake Minnetonka, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Minneapolis (Minnesota). Le décor est assez spartiate. La création empiète largement sur la vie. À une encablure de la cuisine, le salon est transformé en studio, où Prince passe le plus clair de son temps. Jour et nuit, il jette des idées, tape le bœuf avec son groupe, enregistre sur bandes tout ce qui lui passe par la tête. Et comme ils sont déjà plusieurs là-dedans, l’esthétique prend vite forme. Directe, brute, enregistrée à l’instinct, en une poignée de prises, seul, ou presque, dans le studio. Pour épauler l’homme dans son travail de laborantin, une machine : la Linn Drum LM1, l’une des toutes premières boîtes à rythme. Prince dira de sa machine qu’elle lui permet de programmer un beat « en cinq secondes ». Les sessions de fin 1981 jusqu’à l’été 1982 marquent le début de sa liaison avec la boîte à rythme. Sur scène, comme l’attestent les deux lives, audio et vidéo, présents dans le coffret, Prince intègre ses programmations favorites à la batterie électronique jouée par son batteur, Bobby Z, sur scène.
Associée au synthétiseur Oberheim OB-Xa, qui lui permet de moduler ses propres sons, la Linn Drum LM1 conçue par Roger Linn à la fin des années 70, définit le son Prince des eighties.
Le bourreau de travail a trouvé son arme. Il peut ainsi, en solitaire, chez lui ou en studio, s’adonner à l’abattage des chansons qui alimenteront son double 1999, ainsi que les albums de Vanity 6 et de The Time sortis la même année. Au printemps 1982. Prince réside un temps à Los Angeles. Il enregistre durant de longues sessions au Sunset Sound, où lui est dédiée une ingénieure du son, Peggy McCreary. «Il était si prolifique, rapporte-t-elle. Une fois le bouton « ON » enclenché, rien ne pouvait plus l’arrêter.» L’une des images qui, parlant de Prince, revient le plus souvent est celle d’un robinet ouvert 24h / 24h et dont l’eau coulerait sans interruption. «Il ne décrochait jamais, confirme Peggy. Les chansons (de 1999) s’étiraient tellement en longueur… Le pire c’est qu’une fois enregistrées, il fallait y ajouter les « verdubs ». Il avait besoin de dormir, mais jusqu’à un certain point. J’ai lu que c’était une caractéristique des génies : ne pas dormir pendant de longues périodes puis ne faire que ça. Je lui demandais : « Tu as faim ? », il me répondait : « Arrête de tenter de me nourrir, ça me fait dormir. »» Une fois les parties instrumentales fixées sur bande, Peggy réglait le micro puis lui tendait un casque audio avant de quitter le studio pour quelques heures de repos. « Je me souviens d’une fois – il était quatre heures du matin -, il a démarré le moniteur et s’est mis à chanter comme un dératé, en martelant le rythme au sol avec ses pieds. »
C’est à cette époque qu’on le perd. À cette époque aussi que sont enregistrés des titres qui alimenteront les albums à venir : Raspberry Beret (Around The World In A Day, 1985), New Position (Parade, 1986), I Could Never take The Place Of Your Man et Strange Relationship (Sign Of The Times, 1987) pour n’en citer qu’une poignée parmi les quelque soixante-dix chansons tracées, et dont la majorité n’avait jusqu’à la sortie de ce copieux coffret jamais été publiée. Si l’on n’y trouve nulle trace des titres susmentionnés – ces versions initiales sont-elles conservées dans l’optique de les ajouter aux futures réeditions de ces albums ? –, le coffret a le mérite d’ajouter au répertoire des titres dont même les fans les plus aguerris doutaient de l’existence : Rearrange, un funk prototypique d’un des titres emblématiques de 1999, Lady Cab Driver, Money Don’t Grow on Trees, fraîcheur pop et funky, Bold Generation, matrice du titre New Power Generation, paru sur Graffiti Bridge en 1990, Colleen, funk electro à l’os que n’aurait pas renié Philippe Zdar.
Au-delà de la découverte, cette nouvelle édition ressuscite avec un son optimal une poignée de trésors que certains s’échangent sous le manteau depuis la fin des années 80, d’abord en cassette, en CD puis en MP3/Flac. Il ne faut pas passer à côté de la double séquence d’ouverture des inédits, Feel U Up, enchainé avec Irresistible Bitch, démonstration de hard funk synthétique qu’on jurerait jouée en groupe. Les arrangements savants de synthés en lieu et place des cuivres (la signature du Minneapolis sound), la boîte à rythme jouée par endroit comme une batterie, l’entrelacs des guitares rythmiques avec la basse, le chant habité… Tout ici est singulier et ne ressemble à rien d’autre qu’à son auteur.
Pour s’en convaincre, il faudra foncer sur le manifeste Purple Music, cette longue suite progressive de dix minutes, sommet extatique et créatif du coffret (et de son œuvre) qui illustre à lui tout seul le génie de l’artiste.
Ce qui frappe, au fond, à l’écoute des ces « nouveaux » titres, c’est l’étendue du spectre balayé par Prince : funk, pop… mais aussi rockabilly, reggae, blues des origines… Prince ne se cantonnait pas à un genre. Il était un centrifugeur, un shaker, un laboratoire d’expérimentation, capable de fusionner tous les styles de musique en y griffant sa patte, reconnaissable dès les premières mesures, tant cette esthétique sonore ne ressemblait qu’à lui.
En 1982, Prince n’a que 24 ans. Il est déjà au sommet de son art. Mais pas encore à l’apogée de son succès.
Alexis Tain