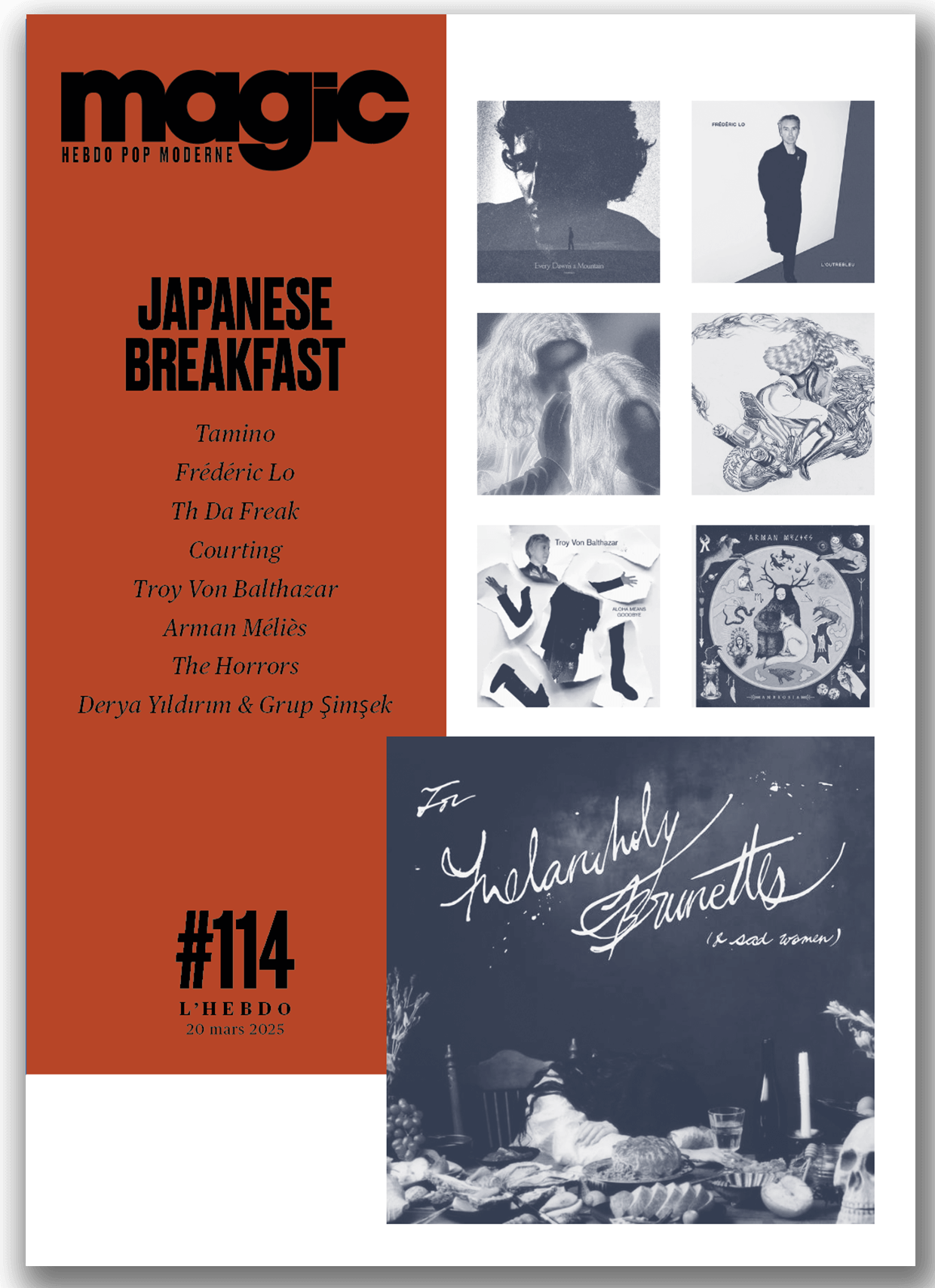Trente-et-un ans, qui dit pire ? En réponse à cette question supposément rhétorique, des phalanges féminines pourraient se dresser. Vashti Bunyan, admettons. Ou Linda Perhacs encore plus récemment. C’est vrai, l’histoire musicale charrie son lot conséquent d’éclipses discographiques prématurées, apparaissant malheureusement souvent comme autant de préludes à des réhabilitations trop tardives et autres exhumations dispensables. Mais contrairement à toutes ces figures autour desquelles finissent par s’élever des cultes dont la ferveur ne s’accroît qu’à proportion de la distance des souvenirs, Ben Watt a triché avec le cours du temps. En effet, les trois décennies qui séparent donc North Marine Drive (1983) et Hendra (2014), soit la première et la seconde étape de cette discographie solo pour le moins clairsemée, n’ont pas été perdues dans les méandres dilatoires des préretraites dont on ne peut ressortir que durablement rouillé. Près de vingt années d’activité musicale intensive avec Tracey Thorn au sein d’Everything But The Girl, puis dix autres entièrement consacrées au développement attentif des musiques électroniques comme DJ, producteur et patron de son propre label Buzzin’ Fly : de quoi bien remplir une existence. Pourtant, l’écoute de ces dix titres suscite l’impression étrange et bouleversante de l’entendre s’exprimer pour la première fois depuis bien trop longtemps dans un registre étonnamment personnel et intime.
Car si Watt n’avait jamais complètement disparu de la circulation, les tonalités confessionnelles de ses œuvres de jeunesse s’étaient estompées pour ne plus réapparaître finalement que dans les pages de ses deux récits autobiographiques, le premier évoquant son expérience de la maladie auto-immune qui le frappa au début des années 90 – Patient (1996) –, le second la vie artistique agitée de ses parents – Romany And Tom (2014). Sans doute à cause d’une forme de discrétion naturelle, certainement aussi parce que la répartition des tâches conjugales au sein d’Everything But The Girl l’avait longtemps relégué dans une posture moins ouvertement expressive, ou encore parce qu’il avait fini par se perdre lui-même de vue à force de se passionner pour les œuvres des autres. Au point d’éprouver un besoin légitime de reprendre aujourd’hui la parole sans plus d’intermédiaire ni de faux-fuyant. “Who am I fooling when I say have no regrets?/You can push things to the back of your mind/But you can never forget”, l’entend-on ainsi chanter sur Forget. À l’évidence, l’art si délicat du songwriting possède ce point commun insoupçonné avec la pratique cycliste : il ne s’oublie jamais. Au contraire, dans ce cas précis, il s’est encore affiné avec les années. Comme pour mieux renouer le fil de ce dialogue précocement interrompu avec l’auditeur, Ben Watt a choisi d’opter pour une forme musicale dépouillée, aux sonorités rondes et où dominent sans partage les guitares et les claviers. Si on y retrouve parfois ce penchant jamais démenti pour l’élégance des rythmes jazzy (Golden Ratio), il ne subsiste quasiment plus aucune trace évidente de modernité électronique.
Pour ce retour à un classicisme folk rock où les traditions britanniques et californiennes s’hybrident harmonieusement, il a su comme toujours s’entourer de collaborateurs aussi précieux que pertinents dans leurs interventions, comme Robert Wyatt avait pu l’être sur les balbutiements du EP Summer Into Winter en 1982 : le fidèle Ewan Pearson, compagnon des années clubbing et déjà responsable de la production soignée des trois derniers disques de Tracey Thorn ; l’ex-Pink Floyd David Gilmour, invité à tricoter des jolis arpèges sur The Levels ; et surtout Bernard Butler, qui a consenti à ressortir ses cordes de gala pour conférer à ses compositions sobres un peu de la flamboyance et du glamour des premiers albums de Suede. Encouragé par ces soutiens attentifs et bienveillants, Watt chante avec une honnêteté et une intensité inédites et accepte de se dévoiler de plus en plus clairement au fil des morceaux. D’abord par personnages interposés – le boutiquier mélancolique d’Hendra, l’adolescent disparu de Nathaniel –, puis de manière directe, évoquant à la première personne les thèmes les plus personnels avec émotion mais sans la moindre sensiblerie : le vieillissement inéluctable, les doutes et les renoncements qu’il engendre (Young Man’s Game) ou la difficulté à préserver la profondeur des sentiments amoureux à l’épreuve du quotidien (The Heart Is A Mirror). Derrière leur apparente simplicité et une évidence presque pop, ces chansons finissent ainsi par révéler des trésors cachés d’expressivité et de nuances. Et quand sur l’avant-dernier morceau, il ose paradoxalement affirmer : “I’m not as good as I used to be”, l’envie nous gagne de lui donner raison. Il vient en effet de prouver qu’il est devenu bien meilleur.