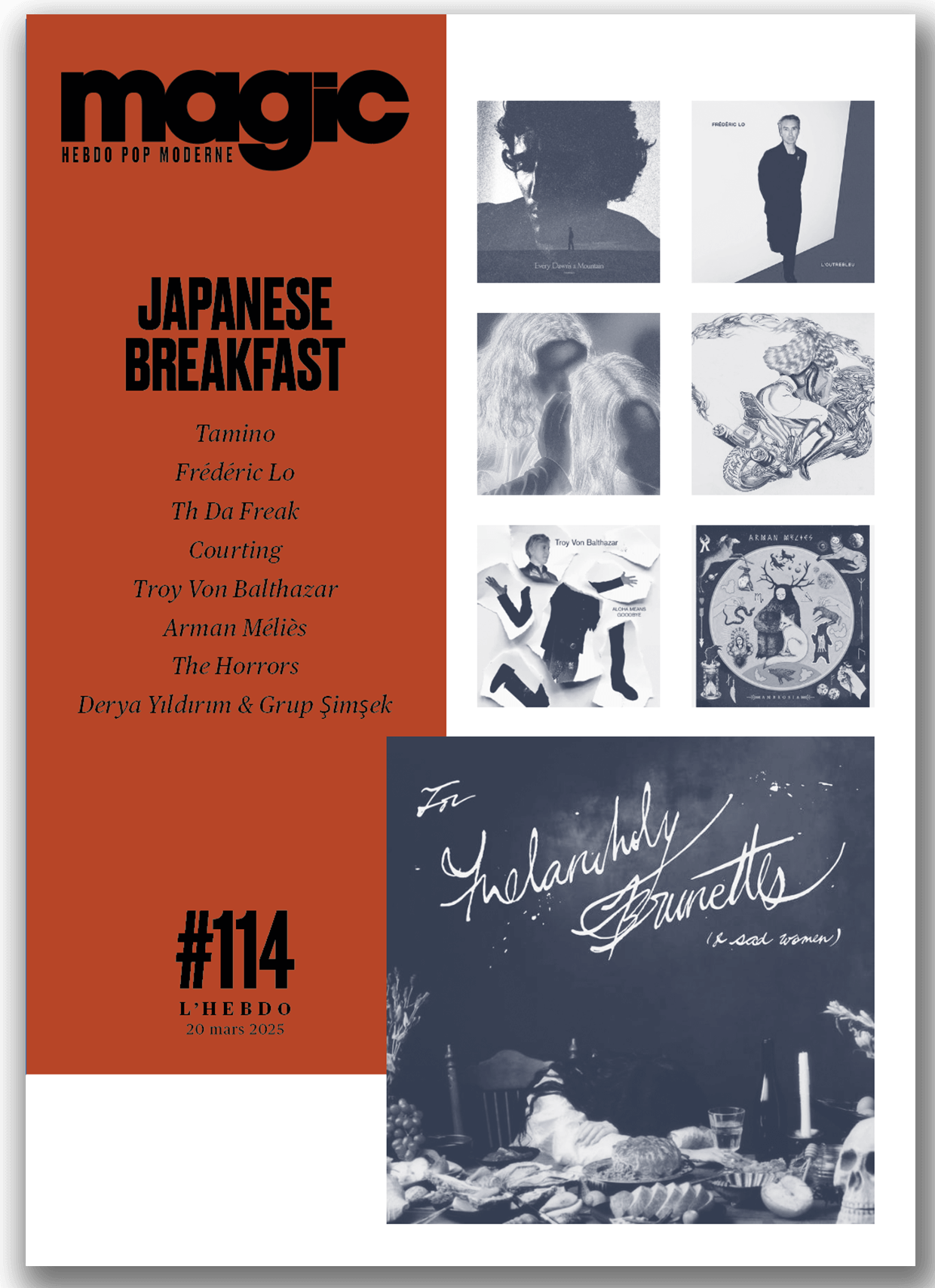“Nous nous sommes séparés, et alors ? Nous n’avions plus rien en commun. J’ai abandonné pas mal de mes idéaux de départ, notamment tout ce qui concerne le refus du succès commercial et la nécessité de souffrir pour être un artiste. J’étais sincère à l’époque mais aujourd’hui j’en ai assez, je voudrais signer sur une major et enregistrer un gros tube qui passe à la radio.” C’est en ces termes pour le moins teintés de provocation que Paul Haig évoquait en 1982 dans les colonnes du magazine Sounds la fin précipitée de Josef K. Au sein de l’éphémère quatuor écossais hébergé par le label Postcard, Haig et son alter ego Malcolm Ross avaient pourtant largement contribué à définir les lignes de force d’une esthétique à la fois punk et discoïde, inventant au passage une sorte de funk blanc minimaliste et acéré qui allait constituer pour les décennies à venir l’essentiel de l’héritage de la fameuse Glasgow School dont Franz Ferdinand – par exemple – n’a toujours pas fini de faire fructifier les dividendes. Alors que Malcolm Ross joue la carte de la fidélité géographique et artistique à ses origines en rejoignant derechef les rangs d’Orange Juice, Paul Haig affiche donc d’emblée des ambitions décomplexées qui s’inscrivent en parfait décalage avec l’esprit indie de ses débuts et ne manquent pas de choquer quelques-uns de ses ex-comparses.
Il y a pourtant bien loin de la parole aux actes et la manière dont il entame cette ascension annoncée vers le sommet des charts ne laisse pas de surprendre : une première cassette, Drama (1981), éditée à 700 exemplaires et entièrement composée de triturations électroniques accompagnant des textes de Kafka ! Fort du succès que l’on devine évidemment fulgurant rencontré par un pareil objet, Haig démarre en 1982 une première collaboration de quatre ans avec Les Disques Du Crépuscule dont quelques-uns des principaux jalons discographiques – des singles pour la plupart, les deux LP Rhythm Of Life (1983) et The Warp Of Pure Fun (1985) ayant déjà été récemment remis à l’honneur – sont ici rassemblés. Désormais installé à Bruxelles, il y développe en l’espace de quelques dizaines de mois les fragments d’une œuvre dont la cohérence apparaît aujourd’hui avec une netteté étincelante et qui contribue largement à établir des ponts jusque-là inédits entre pop, funk – la reprise de Running Away de Sly Stone en témoigne – et musiques électroniques. Un métissage dont les ingrédients – si ce n’est la formule – se rapprochent d’ailleurs du virage amorcé au même moment par Edwyn Collins (son ancien congénère de chez Postcard) sur les derniers albums d’Orange Juice. Sur le premier volet de la compilation At Twilight, on redécouvre donc une série de morceaux dont les titres sont d’une brièveté presque conceptuelle. Comme par exemple Chance avec ses guitares réduites au simple rôle de scansion rythmique tandis que les basses et les claviers prennent en charge le travail d’incrustation répétitive des motifs mélodiques. Time et Justice dont les obscures pulsations synthétiques et les faux airs de ritournelles faciles pour teenagers rappellent forcément les premiers pas de Depeche Mode.
Ou encore Heaven Help You Now qui dégage l’euphorie communicative et la puissance solaire des meilleurs essais de New Order. Une comparaison qui ne doit rien au hasard puisque Paul Haig tisse au fil des singles de nombreux liens avec les artistes et les producteurs qui partagent sa propre conception de la modernité électronique où incursions futuristes et refus de l’élitisme vont de pair, notamment Donald Johnson d’A Certain Ratio et Bernard Sumner de New Order avec lesquels il cosigne l’imparable version longue de The Only Truth où résonnent les échos de Blue Monday et plus globalement l’inimitable patte de Sumner. C’est pourtant sur le second volume de cette copieuse compilation que l’on déniche les trésors les plus inattendus. Citons The Executioner, collaboration longtemps inédite avec Cabaret Voltaire, et surtout une succession de neuf chansons reconstituant pour la première fois dans un ordre cohérent l’intégralité d’un deuxième LP produit par Alan Rankine (The Associates) en 1984 et tué dans l’œuf par la firme Island qui devait en assurer la distribution. Car voilà, tout au long de cette période de transition pourtant parfaitement maîtrisée, Paul Haig ne parvient pas à trouver sa place dans un paysage musical où les clivages demeurent irréductiblement marqués.
Rejeté pour crime de lèse-intransigeance par les premiers fans de Josef K qui ne jurent que par l’authenticité des guitares et aux yeux desquels le terme “disco” demeure souvent un gros mot, il reste trop marginal et réfractaire aux règles du jeu commercial pour s’accrocher aux bons wagons qui conduisent sur le plateau de Top Of The Pops. En dépit d’une coupe de cheveux dont le panache ébouriffé n’a rien à envier à un Howard Jones ou un Nik Kershaw, il refuse par exemple à l’époque de voir son portrait figurer sur la pochette de ses productions. Le séant durablement coincé entre ces chaises antithétiques, il n’en poursuivra pas moins tout au long des années 80 et 90 sa quête inaboutie d’une reconnaissance qui réconcilierait critiques et clubbeurs dans une gigantesque fusion cérébrale et sensuelle. Curieusement passé à côté de la vague electropop sur laquelle ont pu surfer certains de ses contemporains forcément plus célèbres mais pas plus méritants (Erasure, The Human League et tant d’autres), également négligé de manière presque incompréhensible par les premiers thuriféraires de la culture rave, Paul Haig devra patienter jusqu’au XXIe siècle pour bénéficier, suite à la réédition de ses œuvres les plus marquantes, d’une réhabilitation tardive mais justifiée. Comme le confirme paradoxalement At Twilight, c’est donc bien au crépuscule que les ombres finissent parfois par se dissiper.