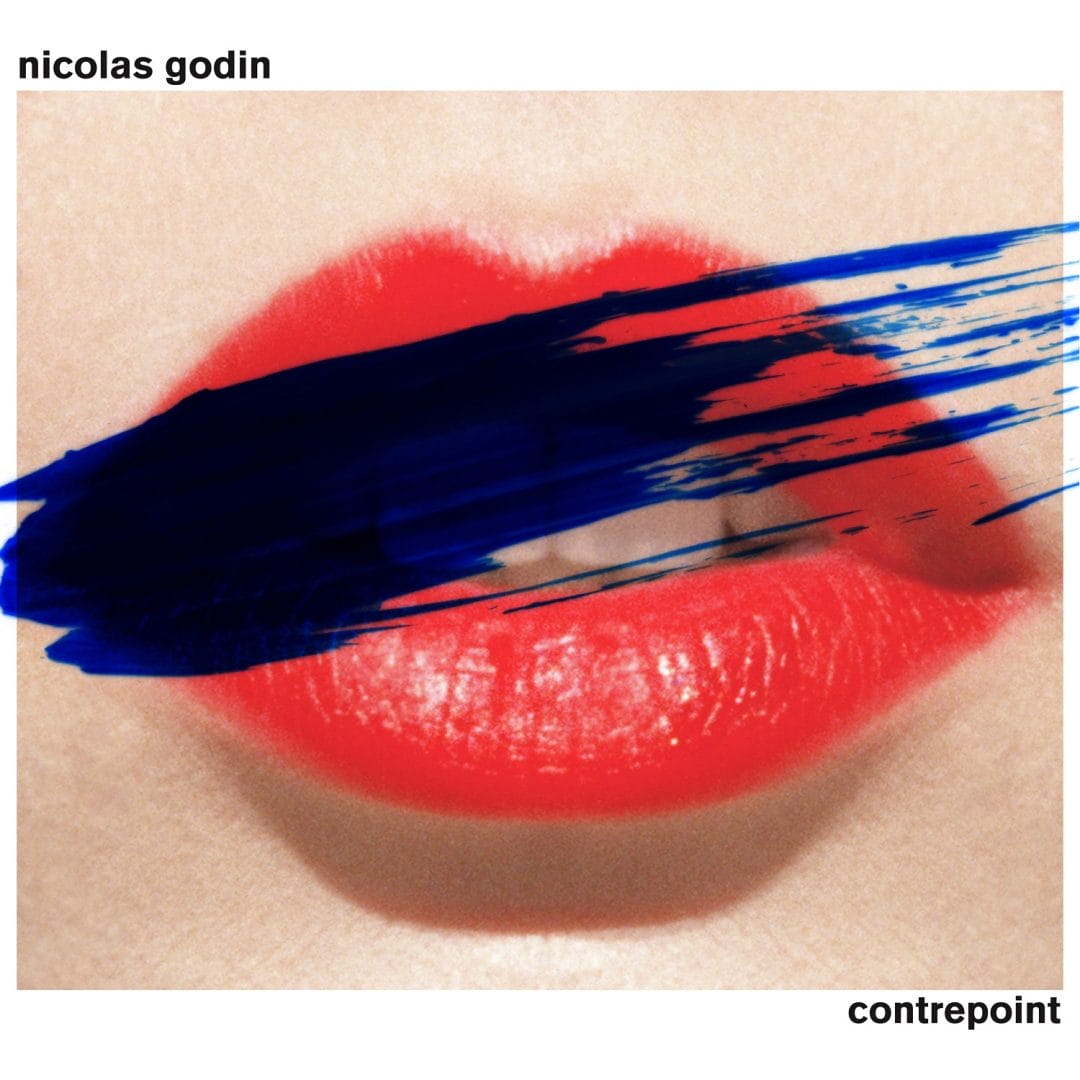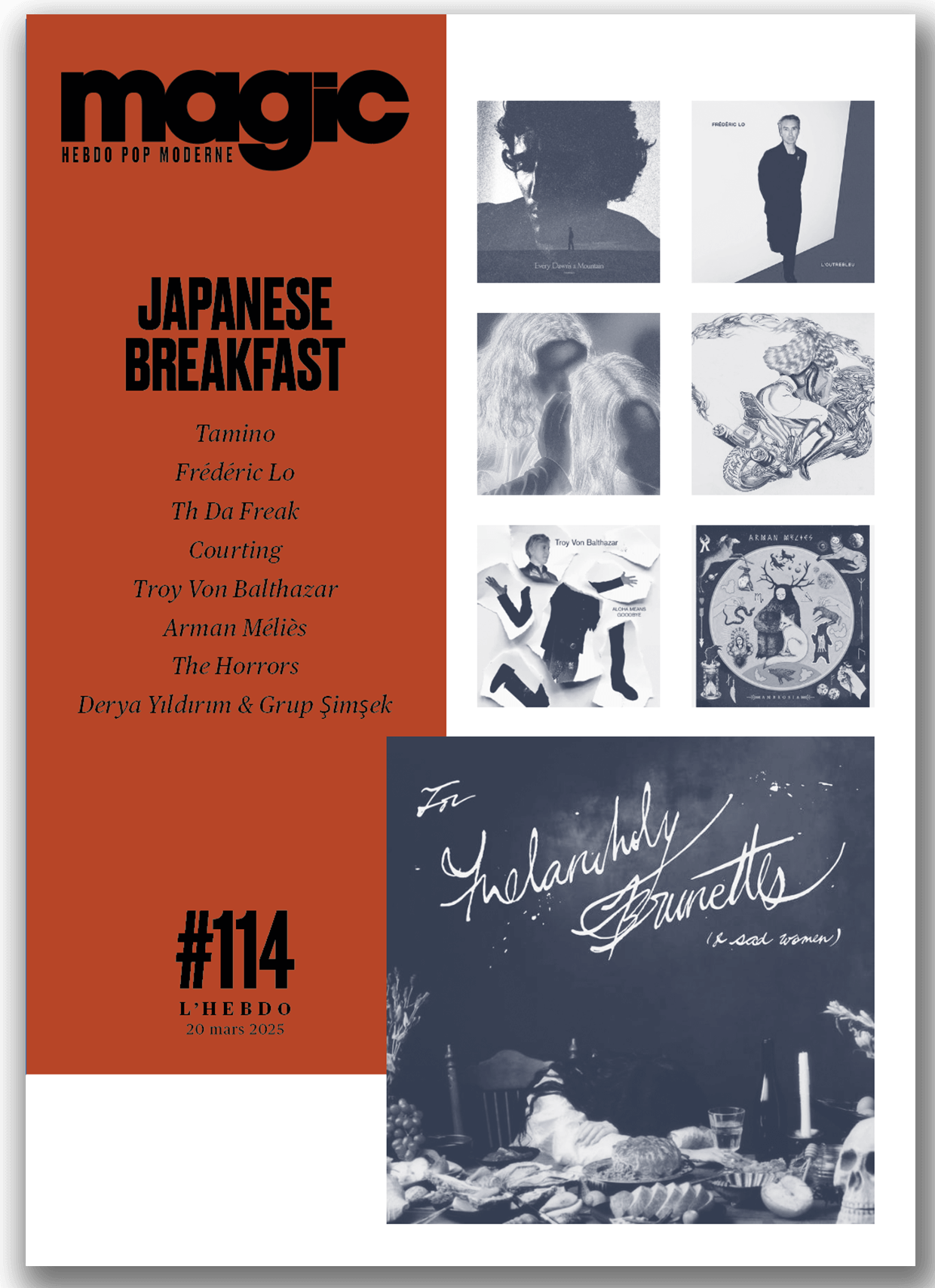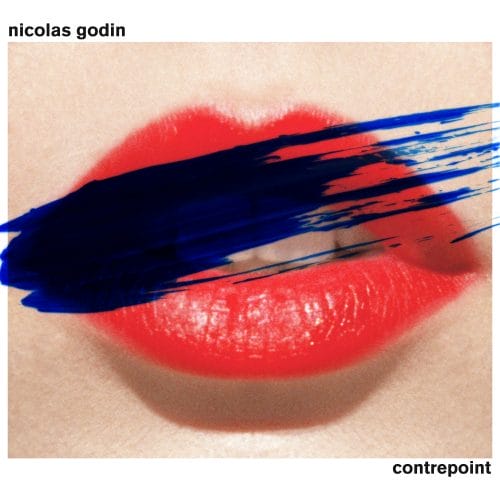(Because/Warner Music)
“S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu”, écrivait Cioran. Plus modestement, la pop moderne peut elle aussi être reconnaissante envers le génie allemand de la musique baroque. Et les tentatives de relectures synthétiques de ses monuments du contrepoint n’ont pas (toujours) été affreuses, que ce soit chez Wendy Carlos (née Walter, une grande amie de Momus), The Zarjaz, Egg, Ekseption, Sky et d’autres.
Malgré cela, on éprouve forcément une forte appréhension lorsqu’on apprend qu’un artiste pop victime de l’hubris va tenter de dépoussiérer la musique du compositeur germanique. D’emblée, le vocabulaire de Nicolas Godin dénote de celui des orgueilleux. Outre le fait qu’on accorde une pleine confiance à son talent, la moitié de Air rassure par sa modestie : “Je ne pensais pas à un album solo, juste à mieux jouer du piano, parce que je n’arrivais pas à jouer Bach assez bien. Mais je voulais aussi vraiment que les gens – pas juste le public classique, mais aussi mes enfants et mes amis – entendent les mêmes magnifiques choses que moi”, confie-t-il dans le dossier de presse.
Pour compléter la genèse de Contrepoint, il faut signaler la présence fantomatique d’un mystérieux troisième homme. La fascination pour l’œuvre de Bach s’est ainsi opérée par l’entremise du passionnant pianiste canadien Glenn Gould, comme ça a été le cas pour plusieurs générations d’artistes depuis 1955 et la sortie de son premier album fondateur, Bach: The Goldberg Variations. Gould, en s’éloignant des poncifs d’interprétation romantique qui travestissaient les partitions originales (les effets de legato et de rubato ad nauseam), a su insuffler une rigueur et une modernité incomparables dans les pièces pour clavecin et pour orgue de Bach.
Fidèle à une sorte de ligne claire et de juste distance, le formidable Godin – qui n’a jamais été du genre à hurler ou à minauder dans le microphone – joue lui sur la sensualité d’une musique pourtant réputée austère. En piochant dans la richesse incommensurable du répertoire de l’Allemand et de son Clavier Bien Tempéré (parfois seulement quelques phrases de piano), Nicolas Godin se permet bon nombre d’audaces. Certaines auraient peut-être déplu au puriste Glenn Gould, qui n’aimait pas le jazz et ne supportait pas la lumière trop criarde des tropiques. Qu’importe, car les deux délicieuses hérésies que sont la très jazzy cool Club Nine et la bossa Clara témoignent d’une liberté et d’une sensibilité peu communes dans le paysage pop contemporain.D’ailleurs, peut-on vraiment parler de pop pour qualifier Contrepoint tant cette collection ne correspond en rien aux clichés du genre (et de ses sous-genres) ? Orca, variation autour d’un prélude de Bach (BWV 848) nourrie de synthétiseurs bien tempérés, donne le ton du disque. Guitare, claviers et violoncelles sont arrangés en toccata dans une production élégante qui rappelle davantage Philip Glass (Glassworks, 1982) que ce que l’on nomme communément (et souvent à tort) la pop baroque. Suit la fabuleuse Widerstehe Doch Der Sünde (“résiste donc au péché”), un chant sacré que Godin prend un malin plaisir à érotiser dans un dialogue caressant entre Gordon Tracks (Thomas Mars de Phoenix) et Dorothée de Koon (Arnaud Fleurent-Didier, Lescop).
Club Nine sonne comme un mélange de Dave Brubeck et de Moon Safari (1997) de Air. Interprété par Marcelo Camelo (Los Hermanos avec Rodrigo Amarante), l’extrait Clara rappelle la bossa-nova délicate de Caetano Veloso à l’époque de son LP magique Domingo (1967), juste avant que le Brésilien ne verse dans le tropicalisme bigarré. Glenn – hommage au maître – comme Quei Due – chanson écrite par le romancier, essayiste et musicologue Alessandro Baricco, complice depuis City Reading en 2003 – peuvent s’entendre comme une invitation au voyage (de Pénélope) imaginaire, et à l’inaction.
Le sample de la voix de Gould que l’on entend à la fin de Glenn exprime une vision de la postmodernité artistique dont le producteur orfèvre fait sa profession de foi tout au long de Contrepoint. Bach Off évoque une bande originale de film sixties composée par François de Roubaix. Enfin, les beaux chœurs féminins d’Elfe Man (en référence au compositeur Danny Elfman) et ses arrangements tout en douceur clôturent dans l’enchantement un album absolument sublime.
Avec une humilité et une élégance étonnantes, Nicolas Godin est parvenu à romaniser et aérer la musique du protestant Bach, c’est-à-dire à rendre une part essentielle de la chair existante dans son écriture. À l’aune d’un tel projet, sombrer dans le kitsch était un écueil évident. Au lieu de cela, Godin nous offre l’un des plus beaux disques qui soit. Depuis quand une œuvre de Air n’a-t-elle pas été aussi bouleversante ?