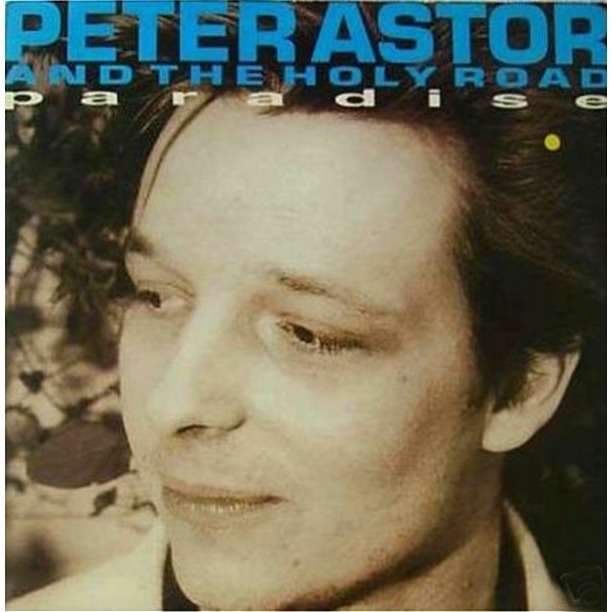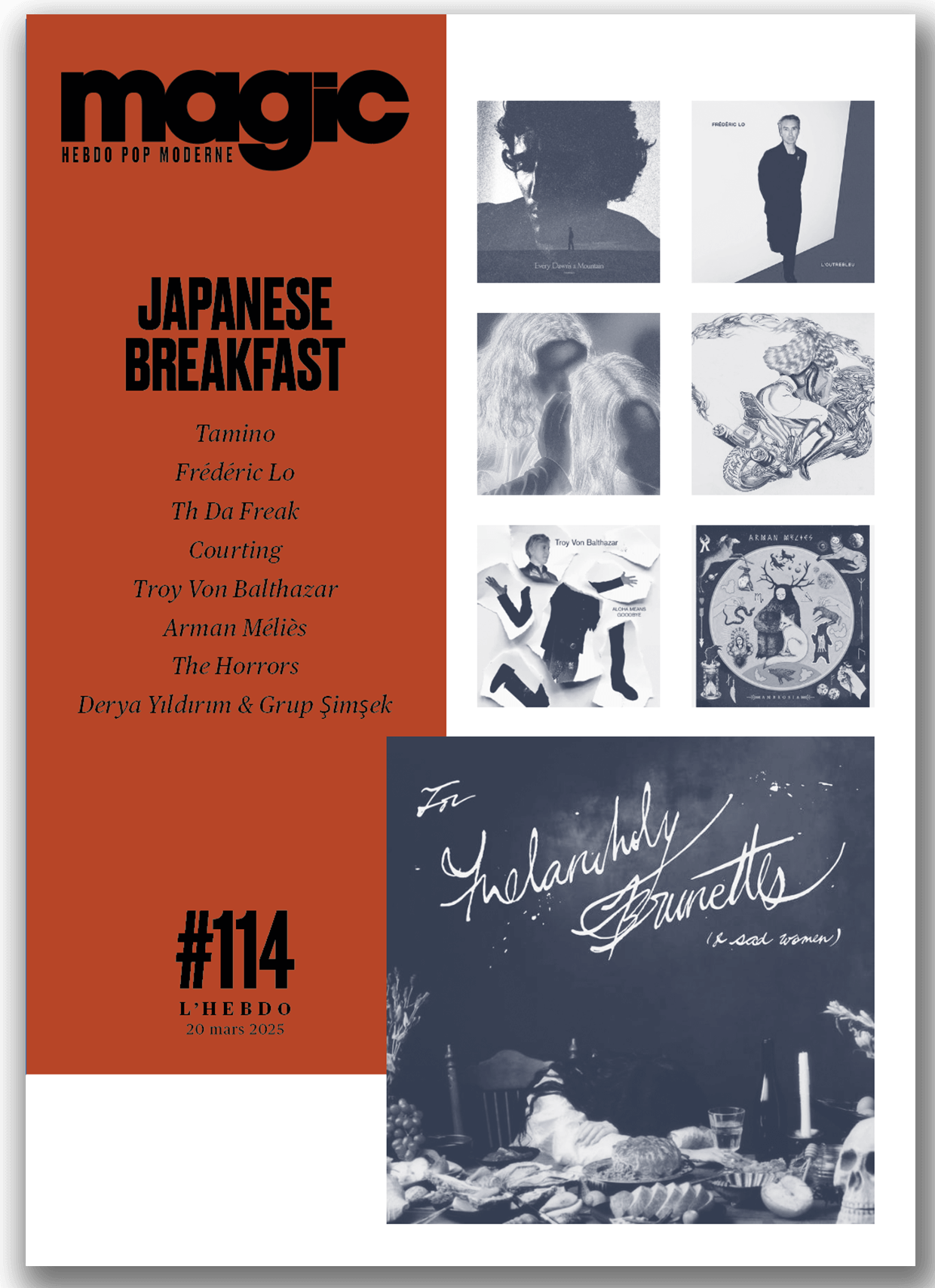Retour sur un grand disque (presque) jamais réédité avec l’album Paradise de Peter Astor, ex-The Loft et ex-The Weather Prophets qui trouva là, en 1992, une porte de sortie éclatante après son départ du label Creation.
ARTICLE Lyonel Sasso
PARUTION magic n°191
LE CONTEXTE
La France est mi-figue, mi-raisin. Le référendum concernant le traité de Maastricht divise. Pas grave ! Renault innove et trouve un consensus nommé Twingo. Mais la joie de l’automobiliste est de courte durée… Le permis à points fait son apparition. Ça valse sec en France. Bernard Tapie a à peine le temps d’admirer son ministère qu’il doit déjà démissionner, inculpé de recel et d’abus de biens sociaux. Ah bon ? Peu avant, c’est le premier ministre Édith Cresson qui quitte son poste, certaines de ses déclarations ne passant pas. Aux États-Unis, Los Angeles s’embrase. Les tensions raciales sont extrêmes et se diffusent à travers le pays. Le modèle américain en prend un coup et le reste du monde entrevoit de flagrantes inégalités. L’Europe centrale est à feu et à sang, le début de la guerre de Bosnie-Herzégovine frappe les esprits. Misère… On a bien besoin de musique. Moose nous sort un alphabet somptueux et incroyable, un grand disque pop. Lawrence s’amuse et ironise en revenant de manière tonitruante (c’est-à-dire avec la vente d’un petit millier d’exemplaires) sous le patronyme de Denim. Leonard Cohen chante The Future tout en nostalgie et ça marche toujours. Television entreprend un come-back pas simple car on pense forcément aux débuts flamboyants, et la comparaison est raide. Mais on s’en fiche pas mal vu qu’on reprend une louche bien pleine de rêves cafardeux signés Nick Cave. 1992, un cru fort en bouche.
LE GROUPE
Roulements de tambours ! Ça se passe sur scène, et le coup est vache. Guerre fratricide entre d’un côté le jeune Peter Astor et le batteur Dave Morgan face au bassiste Bill Prince et l’élégant guitariste Andy Strickland. Les deux camps ne peuvent plus se sentir. Ça tombe bien, ils sont en tournée. Les quatre forment un groupe nommé The Loft. Un beau soir, sur scène, Strickland informe le public qu’il s’agit de leur dernier concert. Un peu auparavant, en coulisses, le guitariste apprend que Peter Astor veut le virer, lui et Bill Prince. Une triste fin. Les débuts se sont pourtant révélés plutôt prometteurs. Ils ont lieu en compagnie d’Alan McGee, le boss de Creation Records. Peter Astor et ses potes s’appellent alors The Living Room, mais le nom est évidemment pris – c’est le blase du club tenu par McGee. Passionnés par New York et l’œuvre de Tom Verlaine, tous optent ensuite pour The Loft. En compagnie de The Jesus And Mary Chain, le groupe s’offre un succès d’estime, le label Creation ayant à l’époque le vent en poupe. The Loft a pour compagnon d’écurie un combo nommé The X-Men. Mais le plus mutant, c’est Astor. Le rôle de leader l’intéresse peu.
Être dans un groupe l’amuse mais il s’ennuie aussi. Il imagine des chansons tout seul, dans sa tête. Après la débandade de The Loft, il fonde The Weather Prophets en compagnie de Dave Morgan. Il s’angoisse un peu, essaie de bien s’entourer. Niveau musique, c’est une banane flambée : côté pile le Velvet, côté face Creedence Clearwater Revival. La suite, c’est magouille de contrats, création de label parallèle, tournée merdique et grosse raclée au niveau des ventes. Ce genre d’embrouilles finit toujours sur un budget obscène et rachitique pour le prochain disque à produire. Astor ne veut même plus en enregistrer. The Weather Prophets part en brioche et l’Angleterre écoute de la dance music. Alan McGee reste un fidèle interlocuteur, et entre deux pintes, Astor se montre prêt à repartir en solo. La nouvelle histoire commence avec un disque entêté et nonchalant à la fois, Submarine (1990). Muni de ses chansons en retrait, entre élégance et suicide commercial, Peter Astor reste d’un flegme so british. L’album suivant, Zoo (1991), confirme un allant autistique improbable. Une sorte de Leonard Cohen horticulteur dans le Yorkshire. Visage poupin, pommettes saillantes et regard bridé, Peter Astor a tout du parfait loser.
L’ALBUM
Comme Peter Milton Walsh de The Apartments, Astor sait qu’une poignée de fidèles le suit en France. Le bonhomme reste sur deux échecs mais se veut souple et en bonne santé. Il écoute son cœur et signe avec le label français Danceteria. Le musicien se passionne pour le jazz, notamment Charles Mingus. Il aime le blues également, c’est l’une des influences en sourdine de sa discographie. On retrouve toutes ces inspirations filtrées, malaxées et recomposées dans Paradise. Ce disque ressemble à un film fantôme. Un road-movie sous un ciel bleu comme l’enfer : le soleil ressemble à un congélateur et les routes s’arrêtent au beau milieu d’un désert. Un Paris, Texas en mode mineur, gangréné de doutes. Les paroles et les mélodies sont comme des mirages, mais l’ouverture est franche. Un tube ! Almost Falling In Love est un trésor pop indémodable. Guitares lumineuses, mélodie à chialer et la voix de satin de Peter Astor qui vient encore nous faire trembler l’échine des années après. Voilà une chanson scandaleusement ignorée mais généralement déterrée sur les réseaux sociaux par des personnes aux goûts sûrs. L’allure reste constante sur She Took The T.V., où on croit deviner que Ry Cooder a totalement ingéré Reckoning (1984) de R.E.M – pas une miette n’a été laissée.
On pense aussi à Lloyd Cole et son art du refrain. Love, Full-On nous plaque sur la figure des arpèges à la Felt. On s’enthousiasme, évidemment ! On cherche même où se cache Maurice Deebank. C’est une belle composition glissante au parfum de rivière. La voix de Peter Astor contient une douceur et un calme fascinants. Agréable comme une averse au mois de juin, son chant fait demeurer les ritournelles dans une sorte de halo mélancolique. Secret Life continue avec ces jeux de lumières incroyables, concluant un quatuor de titres gagnant mené par un même tempo et une même saveur mélodique. Peter Astor imagine là une bossa-nova qui a pour cadre les frimas – pas des masses glamour – de la banlieue de Manchester. Malin, il nous fait voir un rayon de soleil sous le crachin. L’étape suivante, c’est la lunaire Guy Fawkes’ Night, une chanson éthérée, au ralenti. Une pause dans le disque. Si Mickey 3D nous emmerdait avec ses questions à la lune, ici le dialogue est savoureux. Un dialogue mené par un Tom Petty léger et acrobate, enfin convaincant. En fait, tout au long de Paradise, on pense à Tom Petty et George Harrison, les grands artisans pop à la recherche du bonheur.
Pourtant sur l’extrait suivant, c’est comme si on se trempait soudainement les pieds et les chaussures dans une immense flaque d’eau. Donelly est d’une humeur moite, contrariée – le ciel se voile. Mais Peter Astor brise les harmonies, freine et accélère. Les beaux jours reviennent sur The Hotel At The Edge Of The World, avec cette guitare nerveuse qui serpente, sortie tout droit du cerveau de Johnny Marr. Un tube supplémentaire et rafraîchissant. Sideways And The Golden Egg évoque le Tom Waits barré de Rain Dogs (1985), en infiniment plus posé évidemment mais avec cette dose de vice conservée. Lost Soul rappelle franchement Tanita Tikaram et son fameux Twist In My Sobriety (1988), comme une perfusion languide. Le morceau Paradise fait brûler du papier d’Arménie et conclut ce disque sur une voie sacrée, aérienne. Un Leonard Cohen en pleine lévitation.
LA SUITE
Paradise a été un vent de plus. Pas brillant. Peter Astor en a marre du grand cirque de l’industrie musicale, il se dégoûte en s’imaginant être encore un songwriter. Il veut juste disparaître des radars. On le retrouvera dans une université, père de trois enfants, rêvant de composer un hymne country pour Shania Twain, histoire de pouvoir se la couler douce durant sa retraite. C’est une idée. Après des années de disette, Astor finit par reprendre la composition avec toujours une impeccable humilité. Son projet Wisdom Of Harry enfante trois disques chez Matador. Il y mélange ses belles fascinations pour l’électronique, New Order et le dub. Ellis Island Sound est une autre incarnation, plus aventureuse encore, hybride. Astor a aussi fait partie d’un chœur sur une chanson de Hefner. Bref, il ne s’ennuie plus, s’évade et se permet encore de sortir des grands disques. Songbox (2011) en est la preuve. Il reste éternellement ce jeune homme discret et libre. Un héros ordinaire.