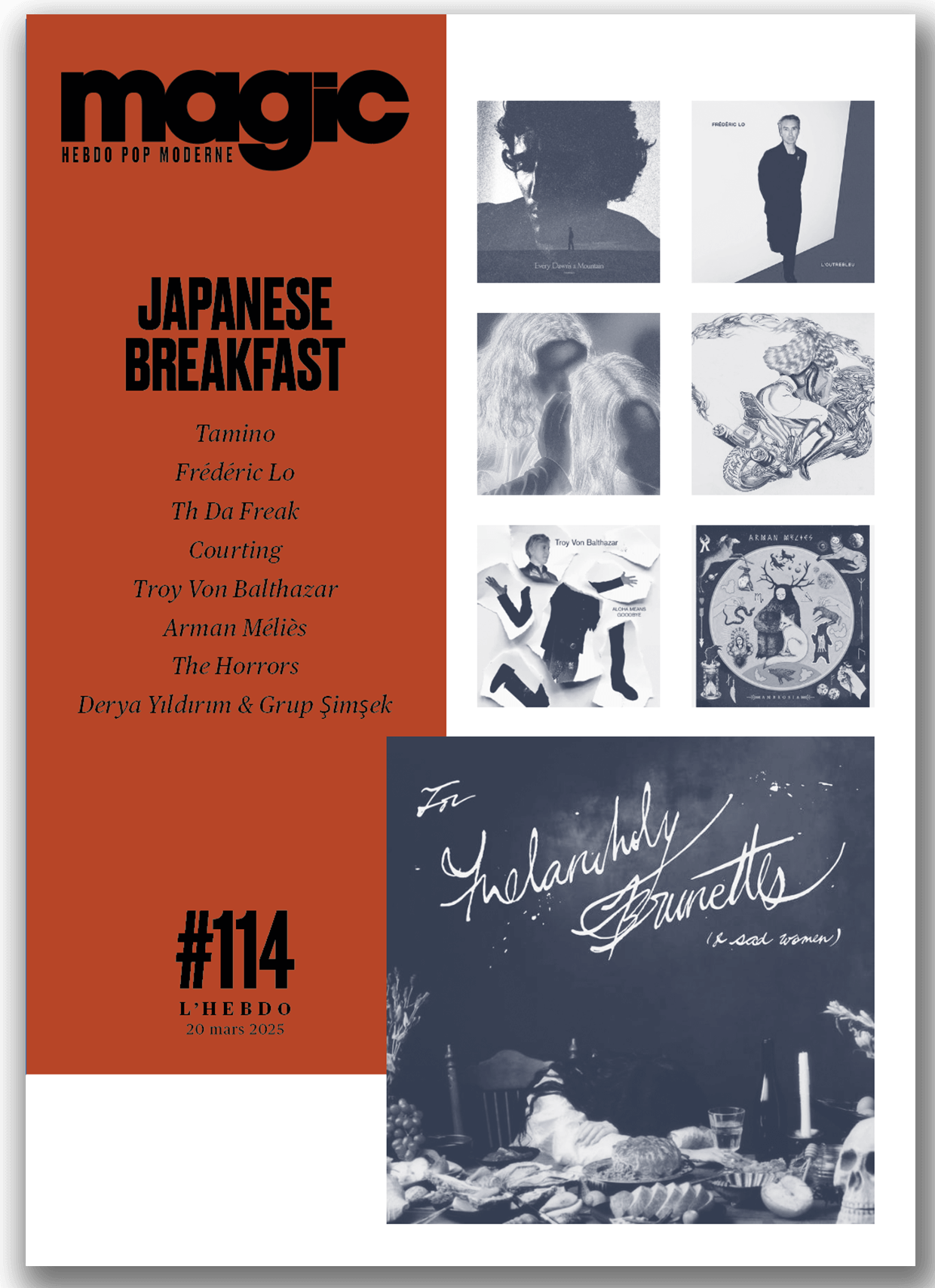Le très prometteur groupe de Liverpool dévoile pour Magic son nouveau single, une reprise des Who, et analyse les liens entre musique et identité britannique à l’approche du Brexit.
Bon sang scouser ne saurait mentir: sur le premier album de The Fernweh, sorti fin 2018 et amoureusement défendu par les fans de pop ouvragée de ce côté-ci de la Manche, on trouve tout ce qu’on a toujours aimé dans la musique de Liverpool, entre ballades marines dignes de Shack et westerns fish’n’chips dans la lignée de The Coral (le disque est publié sur Skeleton Key, le label de leur chanteur James Skelly). Le 29 mars, jour théorique du Brexit, le groupe sortira Sunsighs, un single à double face A contenant une reprise du Sunrise des Who, dont il offre ici la primeur aux lecteurs de Magic, et se produira au Royal Albert Hall. « C’est ironique parce que le Royal Albert Hall représente l’Angleterre victorienne traditionnelle alors que le prince Albert était allemand », explique le chanteur et bassiste Ned Crowther, avec qui nous nous sommes entretenus pour notre dossier spécial Brexit, en kiosques jeudi 7 mars.
Quels sont vos souvenirs du 23 juin 2016, le jour où le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne?
Je me rappelle avoir veillé chez un ami musicien pour regarder les résultats qui ont été annoncés tard dans la nuit, vers quatre heures du matin. D’un sentiment de paralysie et d’incrédulité, suivi d’une frustration croissante puis juste de la tristesse, en fait. Et d’une visite sur le site du bureau des passeports pour voir si je pouvais revendiquer mes attaches françaises: j’ai un grand-père français que je n’ai jamais connu mais ce n’est pas suffisant. En tant que musicien, on réfléchit en termes idéologiques mais aussi très pratiques: immédiatement, je me suis dit que si j’allais jouer en France, en Allemagne ou en Italie, ce serait beaucoup plus pénible sans passeport européen.
Vous revendiquez le caractère profondément britannique de votre musique. Comment se caractérise-t-il?
Pour moi, l’identité et la culture ne sont pas définies en termes très étroits d’État-nation et de drapeau, elles sont davantage un ensemble d’expériences culturelles partagées dans lesquelles nous piochons. Quand je parle de ce caractère britannique, je fais référence à beaucoup de films, de musiques, d’artistes, de paysages: les films de Ken Loach ou Shane Meadows, la beauté lugubre de nos côtes, le travail de la sculptrice Barbara Hepworth et de son mari Ben Nicholson…
Cela ne vous empêche pas de clamer par exemple l’influence des Byrds ou d’avoir choisi un nom allemand, qui signifie « bougeotte »…
L’identité est quelque chose de flexible et en mouvement constant, et je pense que c’est quelque chose qui a été un peu oublié dans le débat sur le Brexit. Regardez la France: le footballeur le plus prometteur du monde est un Français avec des origines camerounaises et algériennes. Votre plus grande pop star est un juif russe dont la muse était britannique et qui a repris l’hymne national avec un groupe jamaïcain. Beaucoup de gens en France n’apprécient probablement pas qu’il soit le plus Français de tous! Je ne connais aucun musicien qui ne se sente poussé à sortir, à bouger, à explorer.
Quel lien faites-vous entre cette identité en mouvement et votre ville, Liverpool?
Les ports sont toujours excitants, dangereux et audacieux: Marseille, Naples, Liverpool… Ce sont des endroits intéressants parce qu’ils ont le regard tourné vers le monde. Pour prendre un exemple célèbre, les Beatles ont existé parce qu’ils récupéraient les nouveaux 45 tours en import grâce aux marins américains avant que Londres ne mette la main dessus. Quand je pense à la musique et à l’identité anglaise, je me demande même ce que cela signifie tant beaucoup de grands groupes anglais sont en fait irlandais: les Beatles, les Smiths, Oasis, The Coral… ont tous des noms et des origines irlandaises. Liverpool est juste le reflet de tout cela.
Vous dites aussi vouloir explorer la violence de la société anglaise.
Il y a beaucoup de beauté dans les paysages ou l’art anglais mais aussi quelque chose de très brutal dans ce pays. Avant que les Français ne débarquent en 1066, nous étions tous des descendants de Vikings: on aime se battre, et cela se vérifie souvent le vendredi soir. Cela a pour partie à voir avec la frustration engendrée par un système très inégalitaire: nous sommes une île où les gens soit canalisent leur énergie de manière créative, et nous l’avons très bien fait au fil des années, soit libèrent leur frustration dans la bagarre.
Quelles sont vos chansons qui reflètent cette violence?
Je dirais qu’il y en a deux. The Liar, le premier morceau du disque, parle d’une histoire vraiment bizarre, possiblement apocryphe: durant les guerres napoléoniennes, un singe en uniforme qui faisait office de mascotte sur un vaisseau français s’est échoué vivant sur la côte nord-est du pays. Comme la Grande-Bretagne était en guerre, la population l’a jugé, condamné à mort et pendu. C’est vraiment bizarre, cette idée d’une île si soupçonneuse envers l’extérieur qu’elle traduit des animaux en justice et les exécute. L’autre chanson qui me vient à l’esprit s’appelle One Hundred Flowers Bloom et est davantage contemporaine. Il y a quelques années, un groupe de Chinois était employé illégalement par un gang à ramasser des coquillages à Morecambe Bay, dans l’ouest du pays, pour les revendre aux restaurants au marché noir. Une nuit, un brouillard très épais est tombé, ils ont perdu leurs repères, ont été piégés par la marée et une vingtaine d’entre eux se sont noyés. Parce qu’ils étaient des immigrants illégaux, on ne leur a jamais vraiment rendu justice. Cela m’a frappé: si sophistiqués que nous nous croyons, des choses terribles de ce genre se produisent encore tout le temps.
Les pochettes de vos singles et de votre album sont très belles. D’où viennent leurs photos?
Il y a quelques années, nous composions le disque sur la côte du Yorkshire à Robin Hood’s Bay, près d’une ville appelée Scarborough, rendue célèbre par la chanson Scarborough Fair. Un endroit riche en histoires folk. On est allés boire quelques bières dans un pub où il y avait un open mic et on a vu un mec étonnant qui chantait de vieilles chansons folk a cappella. On a été lui parler et il nous a expliqué qu’il s’appelait Robin Dale et était aussi photographe. On l’a revu le lendemain et on l’a enregistré lisant un poème pour le dernier morceau du disque, Afternoon Nap. Il a fini par sortir des recueils de photos et je ne pouvais pas en croire mes yeux: «C’est Henri Cartier–Bresson, ce type!» Ses photos sont si puissantes, les histoires qu’elles racontent si fortes, les personnages si étonnants. On a voulu les utiliser pour tous nos disques pour maintenir une unité, un peu comme les Smiths avaient ces supers pochettes si cohérentes pour leurs disques.

Quelle histoire nous raconte la pochette de l’album, cet enfant au visage et aux vêtements noircis par la fumée?
Quand on la découvre, on dirait une zone de guerre, extrêmement dangereuse. Et puis on regarde d’un peu plus près et on voit que c’est la nuit du bûcher, une tradition très populaire en Angleterre, avec un côté gai et un côté sombre. Le côté gai est que, tous les 5 novembre, les enfants passent la soirée dehors, regardent des feux d’artifice, font la fête autour d’un grand bûcher. Mais cette nuit célèbre le destin de Guy Fawkes, un catholique qui avait tenté d’incendier le Parlement et qui a été condamné à mourir de la manière la plus horrible possible, hanged, drawn and quartered: d’abord pendu par le cou jusqu’à être presque asphyxié, puis éviscéré puis découpé en quatre morceaux enterrés à quatre endroits différents afin que son âme ne soit jamais en paix. Toujours la même histoire des deux côtés de ce pays: derrière la beauté, il y a la violence et l’obscurité.
Propos recueillis par Jean-Marie Pottier