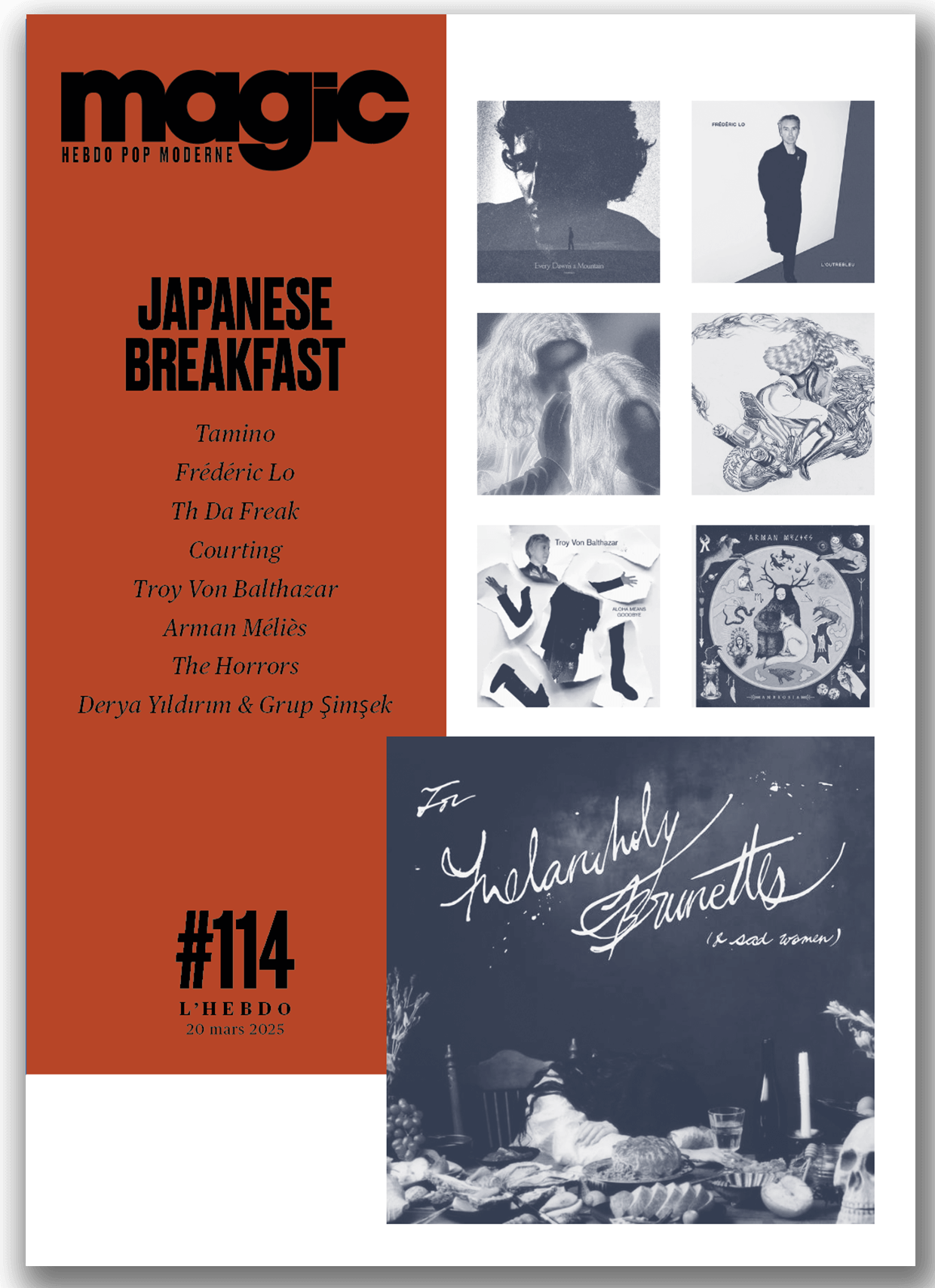Suite et fin de notre compte-rendu de Variations, festival nantais proposant de nombreux concerts de « Musiques pour piano et claviers », pendant une semaine dans divers lieux de la ville. Après l’interview des programmateurs, et une première étape, notre voyage à Nantes se poursuit avec Maya Dunietz, Gabriel Kahane, Villeneuve et Morando feat. Vacarme, Aum Grand Ensemble & Ensemble 0 jouent Julius Eastman + Arthur Russell, Ahmedou Ahmed Lowla…
Variations s’est terminé mardi 30 avril sur un concert (pas vu) de Dead Can Dance. En une semaine, près de 7000 spectateurs ont passé les portes de l’un des sept lieux du festival, dont la programmation éclectique (pop, electro, jazz, classique, contemporain, world) offrait par ailleurs une douzaine de concerts gratuits. Cette pléthore de propositions a permis autant de découvertes musicales qu’un mélange des publics (bienvenu à l’heure du quant-à-soi numérisé), ainsi qu’une réelle expérience, déambulatoire, de la ville et de ses lieux culturels, « officiels », underground ou patrimoniaux. Suite et fin de notre balade nantaise, forcément partielle, mais riche en surprises.
Maya Dunietz joue Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou – Vendredi 26 avril – le lieu unique

Pianiste, compositrice, chanteuse, cheffe de chœur et créatrice d’installations sonores, Maya Dunietz joue les pièces pour piano de la musicienne éthiopienne Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou dans une des salles toutes en longueur du Lieu Unique. Révélée en 2006 par une compilation de la série Éthiopiques, la compositrice, religieuse nonagénaire vivant actuellement au monastère éthiopien de Jérusalem, a demandé à Maya Dunietz de l’aider à retranscrire ses partitions, et lui a confié la tâche de les jouer à sa place quand elle le souhaiterait. Sur un piano à queue, la jeune femme égrène les mélodies flottantes, étrange mariage de musique impressionniste (Satie, Debussy), de jazz (Charles Mingus, Bill Evans), de mélodies pentatoniques ou de blues où le silence nimbe chaque note d’une aura mystique, ou romantique. Parfois, un petit pleur de bébé dans le public, le sifflement d’un train dehors ou la sirène d’une ambulance viennent doucement dissoner ces berceuses vaporeuses. Et lorsqu’une sirène surgit avant que l’interprète ne commence un titre, elle suspend son geste, attend, puis attend encore, la sirène refusant de s’éloigner, et tout le monde attend : « Lorsque cela arrive pendant le morceau, dit-elle, ça n’est pas dérangeant, mais il faut un peu de silence pour pouvoir commencer. ».
Gabriel Kahane – vendredi 26 avril – les Ateliers de Bitche

Ces rencontres impromptues entre la musique et la réalité la plus concrète animent tout le travail récent de Gabriel Kahane, qui présente aux Ateliers de Bitche son dernier album Book of Travelers. En 2016, au lendemain de la victoire de Donald Trump, Gabriel prend la route – ou plus exactement le train – pour sillonner les États-Unis et recueillir la parole d’un pays qui vient de voter. Il bavarde avec des voisins improbables et les dîneurs du wagon-restaurant, et parcourt 8 980 miles (plus de 14 000 km). Seul au piano, ce compagnon de route d’Andrew Bird ou Chris Thile, chante d’une voix haute, douce et souvent émouvante ces récits de voyages vers l’altérité (le texan inculte amateur de barbecue, en gros), entre frémissements impressionnistes et épiphanies schubertiennes. Chanteur littéralement folk (« folks » signifie « les gens », s’il faut le rappeler), Kahane passe de longues minutes entre deux morceaux pour conter sa rencontre avec un chœur de baptistes noirs qu’il a su séduire, lui le juif hobo, et avec qui il a plusieurs jours joué et chanté lors de son long périple. Concluant, un peu idéaliste, un peu donneur de leçons : « Voilà ce qui se passe si on délaisse Instagram quelques temps pour aller à la découverte des vrais gens. ».
On n’aura pas vu le Yaron Herman trio passer de Gabriel Fauré à Britney Spears, ni les multi-instrumentalistes et multiculturels Flamingods enflammer le bar du Lieu Unique, ni le duo entre un piano mécanique jouant Bach et Pierre Rigal dansant autour en costume queue-de-pie. On a aussi loupé Vicky Chow, entourée de 40 haut-parleurs pour Surface Image, une composition pour piano solo et électronique, mais on aura vu un petit bout du concert de l’organiste James McVinnie dans la cathédrale de Nantes, notamment ces Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité d’Olivier Messiaen qui font gronder les grandes voûtes d’ogives et pleurer les nourrissons… Un miroir posé à côté de lui donnait à voir, depuis les travées de la cathédrale, le visage de ce collaborateur de Sigurðsson, Oneohtrix Point Never, Beth Orton ou Bryce Dessner. On se disait que tout le monde regardait devant (la nef) alors que le spectacle se passait derrière (à l’orgue), mais en fait le spectacle, aussi visuel que sonore, était partout.
Villeneuve et Morando feat. Vacarme – samedi 27 avril – les ateliers de Bitche

Suite du marathon de Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando, qui jouaient déjà la veille et l’avant-veille (voir le temps 1 de notre compte-rendu) : le duo électronique retrouve ici le trio de cordes Vacarme (Gaspar Claus, Christelle Lassort et Carla Pallone) pour jouer les titres de leur EP Artificial Virgins, créé en 2016 dans le temple protestant de Lourmarin, dans le cadre du festival YEAH. Pas de temple ni de cathédrale ici, mais le théâtre de chaises des ateliers de Bitche, qui retire sans doute de leur dimension contemplative, sinon liturgique, aux compositions fusionnant cordes et synthétiseurs modulaires. Fusion semble être le bon mot ici, puisque le mariage des sons de synthèse et des textures acoustiques les rendaient parfois indissociables (peut-être aussi parfois à cause du mixage des éléments), les uns et les autres glissant et s’enlaçant en pleins et déliés, dans un frottement général aussi planant que riche à l’oreille. Cette indétermination de la source des sons rendait plus vifs encore les titres en « solo », où le duo électronicien saturait son électricité, quand le trio acoustique s’offrait une sorte de transe médiévale, montant progressivement du silence à la frénésie, du glissando lent au pizzicati en folie, le tout redonnant à chacun sa place dans le spectre sonore. Entre ambient et musique répétitive, mélancolie façon Johnny Greenwood ou variations autour d’un bourdon, cette belle rencontre documente les moyens (les instruments, les idées) avant les fins (une composition, un achèvement), offrant à imaginer d’infinis autres possibles.
Aum Grand Ensemble & Ensemble 0 jouent Julius Eastman + Arthur Russell – samedi 27 avril – le lieu unique

Point d’orgue de cette journée du samedi, l’Ensemble 0 et Aum Grand Ensemble s’associaient dans la grande salle du Lieu Unique pour une soirée dédiée à deux compositeurs new-yorkais atypiques : Julius Eastman et Arthur Russell. Deux artistes majeurs de la fin des années 1980, morts l’un comme l’autre dans la pauvreté et l’indifférence les plus totales, mais qui avaient de nombreux autres points communs. Arthur Russell, violoncelliste, chanteur et compositeur à la frontière du classique, du disco et du folk, a composé Tower of Meaning en 1980 pour l’accompagnement orchestral de l’opéra Medea du dramaturge Robert Wilson, qui l’avait rejetée. La pièce fut finalement dirigée et enregistrée en 1983 par Julius Eastman, compositeur et danseur gay, noir et indiscipliné, auteur de pièces musicales post-minimalistes qui intègreront des teintes pop, et qui mourra dans l’indigence avant d’être récemment réhabilité. Une version un peu différente de Tower of Meaning est jouée au Lieu Unique, où les musiciens ont remplacé un glockenspiel par de petites clochettes qu’ils actionnent chacun leur tour avec leur pied, au milieu d’une succession heurtée de phrases musicales jouées quasi à l’unisson, variant les hauteurs, à égale intensité, en une mosaïque aussi rigide que colorée. A contrario, la musique répétitive de Femenine, la pièce de Julius Eastman, commence par un vibraphone qui jouera la même ritournelle pendant près de deux heures, que tout le reste de l’orchestre (douze musiciens, cordes et vents, pianos et synthétiseurs, une vocaliste) semble reprendre mais en se décalant peu à peu en vagues successives, ondes dessinant dans la grande salle un arbre tournoyant, une spirale multicolore, sertie de veines gorgées de sève pulsante, comme un tronc transcendant. Entre minimalisme et spiritual jazz, c’est une musique qui donne des visions donc, méditative dans ce sens où la méditation, en fixant son objet, lui retire sa fonction et le considère simplement dans sa forme, sa géométrie, sa nature. On saluera l’abnégation des musiciens, notamment du percussionniste principal et de la joueuse de vibraphone, et l’engagement de ces deux ensembles musicaux à offrir cette expérience unique, aussi captivante qu’éprouvante parfois (on pouvait très bien « décrocher » et ne plus entendre du tissage que ses éléments séparés, sans voir le dessin général, le « master plan »). Cela valait bien une petite interview, a posteriori, de Stéphane Garin (percussionniste en chef de l’Ensemble 0) et Julien Pontvianne (clarinettiste en chef du Aum Grand Ensemble), pour mieux comprendre leur travail ici :
Y avait-il pour ces deux pièces des contraintes très précises, ou au contraire, des possibilités d’inventions, de modifications ?
Stéphane Garin et Julien Pontvianne : Eastman, comme Russell, étaient très attachés à la notion d’improvisation à l’intérieur de la musique écrite, à leur rapport/apports mutuels. Comme il a fallu inventer des partitions qui n’existaient pas vraiment, il a fallu déterminer, dans les enregistrements originaux, ce qui était écrit et ce qui était improvisé. Quels squelettes garder pour construire les pièces. Les deux sont d’ailleurs assez différentes de ce point de vue. Tower of Meaning nous semble très écrite et il nous a semblé important de garder le nombre de répétition de chaque section notamment. On a simplement changé l’orchestration et imaginé cette contrainte minime qui consiste à s’aménager, chacun à sa guise, des pauses de quelques mesures, de temps en temps. Femenine, en revanche, laisse plus de libertés. Il y a un processus du début à la fin que l’on suit avec un timing assez précis décidé par Eastman – construire le motif de vibraphone jusqu’à l’unisson, puis construire le motif à l’octave, puis l’allonger, l’harmoniser (dans une gamme qui semble immuable dans l’original, puisque personne n’en sort – Mi b majeur ionien sans 7e), etc. Chaque étape prend plusieurs minutes. Le motif de vibraphone (immuable lui aussi) sert donc à la fois de squelette mélodico-rythmique, de réservoir, de base à des variations improvisées. Eastman qualifiait sa musique d’« organique » dans le sens ou chaque partie découlerait de processus, plutôt lent, et que chaque partie contiendrait tous les éléments des parties précédentes. Aussi, il y a des parties complètement improvisées – celle de piano par exemple, qui prend beaucoup de place dans la version originale. Mais la question se pose, étant donné que c’est Eastman qui la joue : est-ce qu’elle est écrite « dans sa tête », au moins jusqu’à un certain point ? Ou vraiment complètement improvisée ? La frontière est extrêmement poreuse ici entre l’écrit et l’improvisé… Et Eastman ne voyait les partitions que comme des « aide-mémoire » pour les musiciens, sans se préoccuper d’écrire les choses vraiment précisément dans un but de transmission. Sa musique n’était jouée qu’en sa présence à vrai dire, et il discutait beaucoup avec les musiciens lors des répétitions. Pour finir, il semblait aussi qu’il y avait des contraintes implicites de style. Une musique minimaliste écrite par un musicien qui naviguait, entre autres, entre musiques contemporaines, musiques minimalistes répétitives, jazz, mais aussi très impliqué dans l’avènement du disco… Se plonger dans la vie de Julius Eastman nous a confirmé par exemple que cette « basse » presque « disco » (et apparemment improvisée), que la danse, était quelque chose de très important, qui participait énormément à la singularité de la pièce. Et donc qu’il fallait prendre ça comme une contrainte à extrapoler.

Quelle était la fonction des petites clochettes posées sur le sol, et que les musiciens actionnaient régulièrement pendant la pièce d’Arthur Russell ? Un changement de hauteur ? Le retour à un moment précis de la partition ? Etait-ce une contrainte liée à la partition originale, ou un apport dans votre interprétation ?
Il s’agit de la partie de glockenspiel que l’on entend sur l’enregistrement original. Le timbre du glockenspiel n’est pas toujours reconnaissable (dû au ralentissement de la bande) ce qui lassait une certaine liberté pour choisir le timbre. Aussi le choix de mettre les deux percussionnistes sur le vibraphone avec deux archets chacun faisait qu’il fallait confier cette partie de glockenspiel à un autre musicien, mais comme personne n’avait les mains libres, on a décidé de répartir le glock en une cloche chacun. La partie en elle-même ne découle, il me semble, d’aucune logique, et n’est pas non plus un quelconque signal. Arthur Russell, apparemment, aurait écrit une astérisque au-dessus de certains accords, signe pour le percussionniste de jouer la 1ère voix de cet accord.
De la même manière, y avait-il une contrainte « oumupienne » (si j’ose dire) dans Femenine ? Des décalages progressifs ? Des parties jouées par les uns puis par les autres, parfois au sein même d’une même phrase musicale ?
On ne parlera pas de consignes genre Oumupo. C’est un peu plus pragmatique que ça, moins « ludique ». Tout découle du motif de vibraphone : les motifs de base dont les autres musiciens improvisent des variations, les endroits on l’on attaque les motifs ou les notes tenues… Il y a des contraintes de temps et de nombre de répétitions des cellules, ce qui créé des canons improvisés en effet…
On finira au bar du Lieu Unique à danser sur les reprises jazz-techno de Sun Ra ou de l’Art Ensemble of Chicago par Etienne Jaumet, puis sur les transes hachées menues d’Ahmedou Ahmed Lowla, star de la musique instrumentale mauritanienne, jouant avec autant de virtuosité que de frénésie de son clavier oriental Yamaha (à variations de tonalités arabes), sur les rythmes compliqués de son acolyte percussionniste, le premier enjoignant sans cesse le second à s’adapter au sens du rythme de ce public occidental qui ne sait taper dans ses mains que tous les 1er temps d’une mesure binaire. L’ivresse aidant, chacun fera sienne cette dance-music saharienne, preuve s’il en est que ce genre de festival, mélangeant les publics, les styles et les cultures, peut toucher bien au-delà des « niches » auxquelles nous restreignent la musique de « recommandations ». On leur souhaite de nombreuses autres Variations.