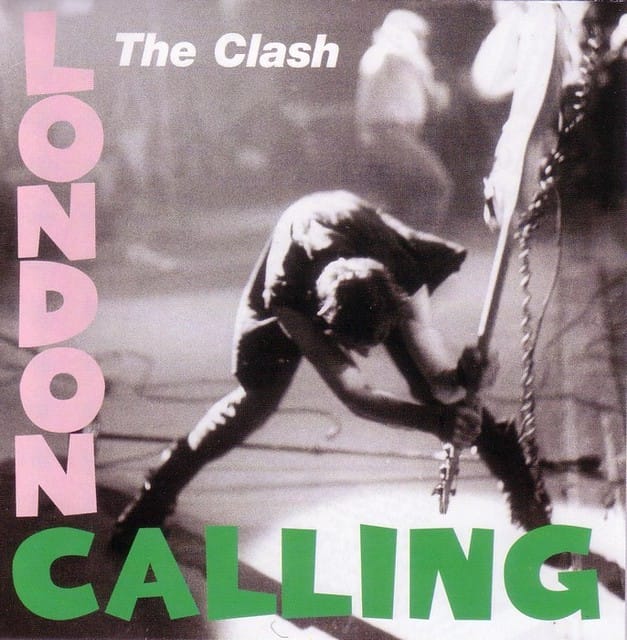L’album-phare du Clash, "London Calling", missive apocalyptique contre les politiques d’austérité, le racisme, les désastres climatiques et le consumérisme, semble avoir été écrit hier. Il est sorti le 14 décembre 1979 dans les décombres d’une Angleterre au bord du gouffre.
Un article initialement paru dans notre numéro 219 sous le nom « La guerre est déclarée« .
Historique, intense, sauvage. Ce soir du 31 janvier 1979, à Vancouver, l’atmosphère est électrique dans la fosse du Commodore. Pour la première date de sa tournée nord-américaine, le Clash rend la foule complètement hystérique au moment de reprendre en chœur London’s Burning. La capitale britannique agonise à plus de sept mille kilomètres de là. Depuis quelques semaines, le winter of discontent, «l’hiver du mécontentement», fait rage en Angleterre. Même les croque-morts ont stoppé toute mise en bière dans un pays déjà très affaibli par la crise. Emmenée par Margaret Thatcher, l’opposition conservatrice entend rendre la Grande-Bretagne «à nouveau grande», en un slogan qui trouve écho dans les actuels «Let’s Take Back Control» des partisans du Brexit ou «Make America Great Again» des trum – pistes. Une révolution conservatrice s’entrechoque avec celle de la jeunesse punk. Quand le Clash revient de son Pearl Harbour Tour, il est forcé de prendre un angle plus directement contestataire après avoir incarné un mouvement punk longtemps réfugié dans des slogans situationnistes. Il ne le sait pas encore, mais il va accoucher d’un des disques les plus importants de l’histoire du rock, un double album colérique qui ne vieillira ni par le son, ni par son actualité. «Tout est là, analyse Julian Yewdall, photographe aux avant-postes des premiers instants du Clash. C’est un cri de guerre lancé aux quatre coins de la nation et du monde qui est encore d’actualité. La montée en puissance de gouvernements qui utilisent de plus en plus de moyens pour contrôler leur population, le recours accru à l’énergie nucléaire et à ses risques, notre dépendance au pétrole et aux pesticides, les conséquences du réchauffement climatique, la montée du nationalisme, le Brexit, c’est dans la continuité de ce que dénonce cet album.» Avec la mort par overdose, en février 1979, du bassiste des Sex Pistols, Sid Vicious, le no future s’essouffle. «Au moment où les Sex Pistols ont implosé, le pouvoir initial du punk était épuisé, sa marchandisation n’en avait fait rien de plus qu’un objet à la mode, se souvient Julian Yewdall, qui fut un temps harmoniciste du premier groupe de Joe Strummer, The 101’ers. Le nihilisme, l’anarchie et le chaos étaient devenus indéfendables, avec beau – coup de dégâts collatéraux». Ensemble, ils ont vécu dans un squat du West London, comme cinquante mille autres personnes dans toute l’Angleterre. «Le squat était beaucoup plus inspirant politiquement que tout ce que le punk avait à offrir. On manifestait beaucoup pour qu’il reste légal mais c’était de plus en plus compromis» .
THATCHER ET THREE MILE ISLAND
Joe Strummer s’est, dès les débuts du Clash en 1976, impliqué dans des causes sociales. Avec le bassiste Paul Simonon, il est allé jusqu’à participer aux émeutes du carnaval de Notting Hill le 30 août 1976, quand Blancs et Noirs ont affronté la police sous une canicule accablante et apocalyptique comme l’Angleterre n’en avait jamais connue. White Riot, paru sur le premier album éponyme The Clash (1977), relate ces événements dans un déluge de guitares distordantes. Introduit par un son de sirène de police instillant un sentiment d’urgence, le single ne sera commercialisé aux États-Unis que deux ans plus tard, en juillet 1979. Entre temps, la tension est montée d’un cran outre-Manche. En avril, le militant contre l’extrême droite Blair Peach est tué lors d’une manifestation dans le South London. Le 4 mai, le gouvernement travailliste de James Callaghan, renversé fin mars par une motion de censure, est sèchement battu et Margaret Thatcher devient Première ministre. Peu de temps après ce jour historique, le tour manager du groupe, Johnny Green, repère dans le Melody Maker une petite annonce pour un nouvel espace d’enregistrement: Vanilla Studios, à l’arrière d’un garage de Pimlico, à côté du pont de Vauxhall. Contraint de quitter ses studios de Camden Town après avoir viré son manager Bernie Rhodes, le Clash va y prendre ses quartiers. Au milieu des carcasses de voitures et des vapeurs de caoutchouc échappées d’une usine, il faut tout reprendre à zéro. Alors que Joe Strummer n’a rien écrit depuis plus d’un an, l’actualité politique récente s’avère être très inspirante. En quelques jours, le groupe met sur bande un EP enregistré à la hâte qui sort le 11 mai, The Cost of Living («Le coût de la vie»). La pochette, d’abord pressentie pour afficher le visage de la Dame de fer dans une swastika, finira en pastiche de publicité pour détergent à la demande du guitariste Mick Jones. Le disque, qui s’ouvre sur une fougueuse reprise du I Fought the Law de Sonny Curtis, préfigure le son de London Calling. «Joe avait toujours considéré le punk comme un moyen de parvenir à ses fins mais il était hors de question qu’il continue à produire des albums identiques pour le reste de sa vie, résume Julian Yewdall. Il voulait explorer d’autres horizons». Le Clash s’émancipe désormais en exprimant sa conscience politique plus directement, jusqu’à décrire des faits divers récents. L’exemple le plus probant est la chanson-titre du nouvel album. L’explosion le 28 mars de la centrale nucléaire de Three Mile Island, aux États-Unis, y est comparée à l’élection de Margaret Thatcher, «une erreur nucléaire». Le texte est une missive virulente envers l’ancien monde et sa «Beatlemania bidon», dénonce «le règne de la matraque», annonce l’arrivée d’un «âge de glace» et appelle garçons et filles aux armes. Dans son livre A Permanent Record (West Nine Publications, 2012), Julian Yewdall rapporte ces propos de Joe Strummer : «L’autorité est supposée être fondée sur la sagesse mais j’ai vu très tôt que l’autorité était un système de contrôle et qu’elle n’avait aucune sagesse inhérente. J’ai vite compris que si vous ne deveniez pas le pouvoir vous-même, vous étiez écrasé.» Sur le plan musical, London Calling est en rupture avec le son écorché du premier album comme avec celui, chromé, de Give’em Enough Rope (novembre 1978). L’apport de la basse de Paul Simonon y est pour beaucoup. Elle retentit comme pour avertir d’une menace, que quelque chose va arriver, que rien ne sera plus comme avant. Un groove guerrier emprunté au reggae, qui le passionne. Lui qui a grandi dans le quartier jamaïcain de Brixton, au sud de Londres, a été marqué par The Harder They Come (1972), un film de Perry Henzell qui narre l’histoire d’un jeune dealer jamaïcain en cavale, Ivanhoe ( Jimmy Cliff ), tué à bout portant par des policiers. Pour la première fois, Simonon prend la plume et écrit le texte de Guns of Brixton en s’inspirant de cette histoire qu’il rapporte au quartier de son enfance. «Tu vois, il se sent comme Ivan / Né sous le soleil de Brixton / Sa seule distraction est d’essayer de survivre / À la fin de The Harder They Come». Paroles prophétiques : deux ans plus tard, la communauté afro-caribéenne de Brixton les reprendra à son compte lors d’émeutes particulièrement violentes. «Thatcher était sans complaisance envers les minorités, commente Gilles Leydier, professeur à l’université de Toulon et spécialiste des institutions politiques britanniques. Ses multiples réformes anti-immigration ont fait se soulever ces populations, déjà affaiblies par la crise économique, à Londres mais aussi à Liverpool et à Birmingham. L’opposition était frontale». Frontale comme l’ouverture de Guns of Brixton: «Quand ils frapperont à ta porte / Comment sortiras-tu? / Avec les mains sur la tête ? Ou le doigt sur la gâchette ?» Trente ans plus tard, l’histoire se répétera, la boucle se refermera: en 2011, après des émeutes urbaines dans tout le pays, sort une reprise de Guns of Brixton signée… Jimmy Cliff. Lorsque le Clash quitte Pimlico, en août, pour enregistrer à Wessex, une ancienne église victorienne reconvertie, là même où les Sex Pistols avaient enregistré Never Mind the Bollocks pile deux ans auparavant, sa besace est chargée en textes qui font mouche. Mais la totalité des dix-neuf chansons qui composent l’album n’est pas encore écrite. Joe Strummer va trouver l’inspiration non loin d’ici. Un soir, sur le chemin qui les ramène à leur domicile, sa compagne Gaby Salter et lui débattent de l’ETA, le mouvement séparatiste basque qui sévit en Espagne. Joe s’est rapproché depuis peu de la Movida, mouvement hispanique affilié au punk apparu après la mort de Franco. De cette discussion naît Spanish Bombs, morceau en partie écrit en espagnol et truffé de références au poète assassiné Federico Garcia Lorca et à la guerre civile de la fin des années trente. À côté de son domicile, Joe fait ses courses à The International, un supermarché de King’s Road: il retranscrit son ressentiment et s’inspire de l’enfance de Mick Jones – qui chantera la chanson lui-même – pour en faire un hymne contre le consumérisme, Lost in the Supermarket. Un angle d’attaque qu’il réitère dans Koka Kola: «Ton costume en peau de serpent et tes bottes en alligator / Tu n’as pas besoin d’une laverie automatique, tu peux les envoyer chez le vétérinaire!»
PUNK ET REGGAE, MÊME COMBAT
Aux manettes de London Calling, le Clash fait appel à Guy Stevens, icône mod et ancien DJ du Scene Club. Le producteur est un spécialiste des différentes musiques noires, et c’est justement la couleur que veut donner le Clash à cet album profondément révolutionnaire, dans la forme comme sur le fond. Mais avec Stevens, le groupe s’achète aussi une crédibilité auprès des mods britanniques et des minorités issues des ghettos, dont certains sont devenus désormais des skinheads, mouvement qui mélange à ses débuts les Blancs et les Noirs. Pour être sûr d’atteindre sa cible, le Clash insiste auprès de son label pour vendre ce double album de dix-neuf titres au prix d’un simple. «C’est comme ça qu’ils ont su rester fidèles à leurs fans, même si ceux qui étaient plus proches des Sex Pistols étaient clairement déçus par un album aussi éclectique musicalement, analyse Julian Yewdall. Mais le groupe savait qu’il fallait s’éloigner des clichés du punk». Vieux punks et fans de la première heure n’ont pas compris le principe: les liens entre punk et reggae sont originels, presque métaphysiques. Dans son livre Sous-cultures: le sens du style, paru cette même année 1979, le sociologue Dick Hebdige décrit le point de convergence entre ces deux mondes que tout semblait pourtant opposer. Il se remémore cet été caniculaire de 1976 où la première vague punk est apparue sur King’s Road en même temps que les émeutes du carnaval de Notting Hill: «La rhétorique du punk était saturée de motifs apocalyptiques, puisant dans l’imagerie éprouvée de la crise et du changement brusque. Même les moments forts du punk sont des produits hybrides, confluence instable et malaisée de deux langages radicalement différents, celui du rock et celui du reggae.» London Calling sort au Royaume-Uni le 14 décembre 1979 et au début de l’année suivante aux États-Unis : l’album sera, ironie chronologique, sacré par Rolling Stone meilleur disque… des années 1980. La décennie qui s’annonce sera bien le prolongement de l’année qui a vu naître ce chef-d’œuvre. Peu avant sa sortie, Ronald Reagan annonce sa candidature à la Maison-Blanche. C’est un mois avant son entrée en fonctions comme président des États-Unis que le Clash sort Sandinista!, triple album dont le titre est un hommage aux rebelles à la dictature nicaraguayenne d’Anastasio Somoza, opposition que l’administration Reagan tentera elle-même de renverser. Avant la dissolution définitive du groupe en 1985, Joe Strummer, en bon Européen, va poursuivre son immersion au sein de la Movida en Espagne, notamment à Grenade, pendant que Thatcher mine l’Europe à grands coups de «I want my money back». «Elle a lancé l’euro-scepticisme et Boris Johnson s’inscrit dans cette continuité-là, rappelle Gilles Leydier. D’ailleurs, un Brexit, elle en aurait rêvé !». Quarante ans plus tard, London Calling n’a pas fini de tourner. En novembre, tandis que s’ouvrait au Museum of London une exposition en hommage à l’album, «BoJo» lançait dans une vidéo de campagne que son groupe préféré était «soit le Clash, soit les Rolling Stones», quelques semaines avant son triomphe électoral du 12 décembre. Now, the war is declared.