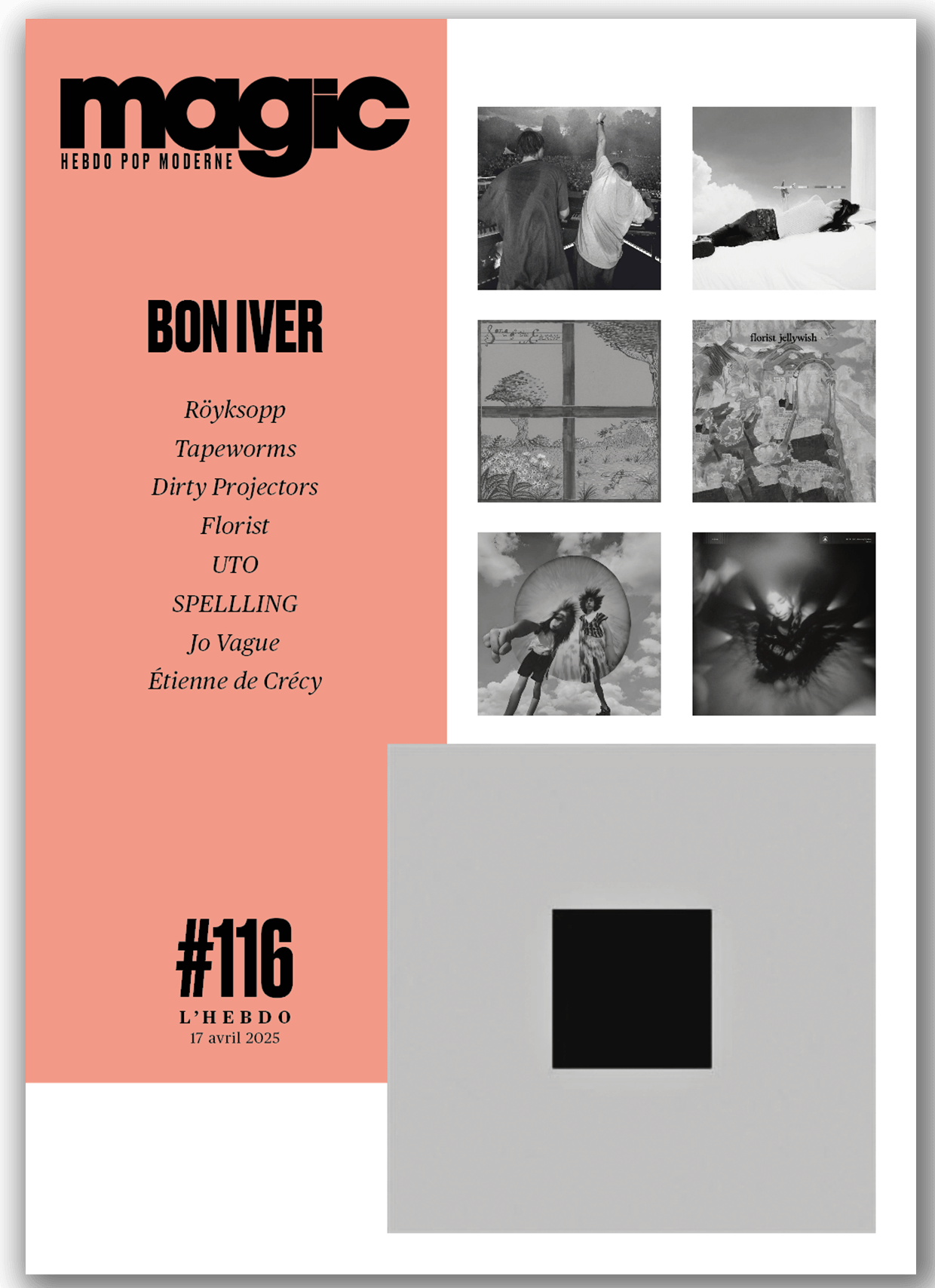Apparu en 2003, I Love You But I’ve Chosen Darkness – l’un des plus beaux noms de tous les temps – est une formation rare et pas seulement parce que sa discographie se résumait jusqu’à ce retour inespéré à un unique album (Fear Is On Our Side, 2006) et deux EP. Rare car unique en son genre, creusant la frontière d’une new-wave lyrique et contagieuse sans jamais tomber dans le piège d’une détestable emphase au rabais, cette maladie même pas honteuse du rock (suivez mon regard). La question brûlante : en quoi ce groupe dépasse son style et ses concurrents ? Comment Christian Goyer et ses hommes arrivent-ils à se démarquer des emplâtres jouant dans les stades en produisant une musique à peu près similaire (qui vient de là, qui vient de la cold-wave) tout en restant intouchables, précieux et définitivement à part ? Peut-être simplement un besoin de se consacrer plus à sa musique et d’y mettre toute son âme plutôt que de s’adonner à des ambitions carriéristes. Les huit ans qui séparent Dust de son prédécesseur semblent n’avoir eu absolument aucune incidence, aucune prise sur ILYBICD, ni sur le son (c’est toujours Paul Barker de Ministry qui produit) ni sur l’écriture.
Une petite armée de fans exsangues dont une bonne partie de la rédaction de ce magazine y retrouvera donc la même lumière noire, la même dépression bienveillante, et le même besoin d’y retourner aveuglément. Avouons-le tout de même, la première écoute de Dust est un peu décevante, mise à part l’immédiateté de Faust, cette impériale entrée en matière qui ravive rapidement l’affection, et Come Undone, grand morceau aérien et contagieux. Une fausse déception qui se transforme rapidement en plaisir insidieux tant les autres titres ont depuis fait leurs chemins dans nos vies. Certes, on aurait aimé plus de tubes, mais c’est justement dans ces clairs-obscurs (Stay Awake, Safely) et ses midtempos impressionnistes (You Are Dead To Me, immense The Sun Burns Out) que se joue le mystère de ce groupe – toujours une question d’attente, permanente et finalement assouvie. On songe à Killing Joke qui aurait réussi son passage de la sauvagerie vers la lumière blanche (l’insupportable et pourtant fascinant Brighter Than A Thousand Suns, 1986), éliminant la graisse et les faux emportements pour ne garder que la juste mesure, les lignes de basse inoubliables, les entrelacs de guitares vénéneux. L’alchimie des Texans ne s’explique toujours pas, et c’est tant mieux. On attendra le temps qu’il faudra pour la suite des évènements, au garde-à-vous s’il le faut.