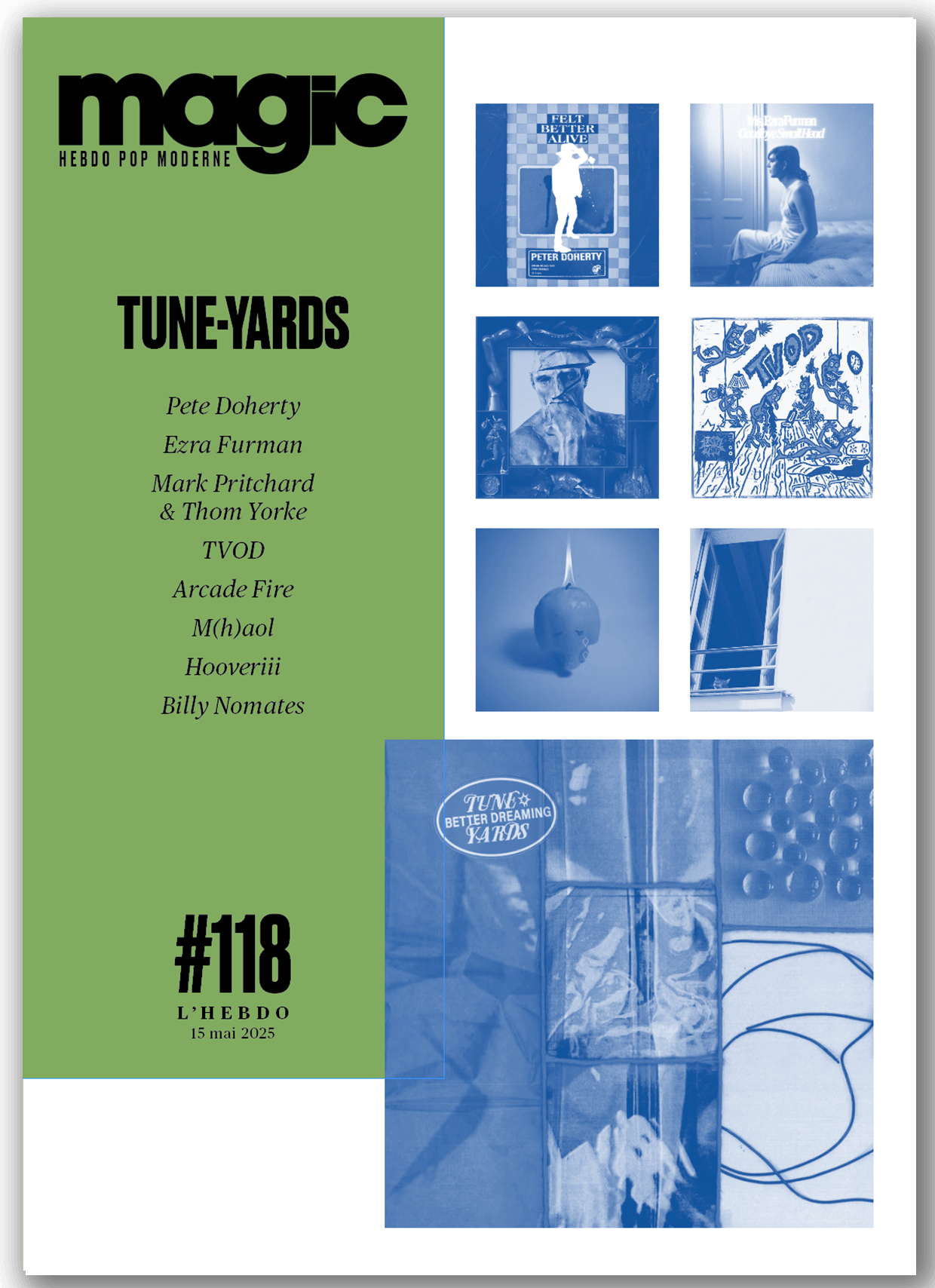Le gars a beau nous dire que Father John Misty n’est qu’un pseudonyme comme un autre, on ne peut s’empêcher de penser autrement. Assurément, à un moment de son drôle de parcours, Josh Tillman a ressenti le besoin de rompre avec son personnage de songwriter à guitare acoustique. Ce discret chanteur folk était touchant et fragile, certes, mais souvent affecté à l’outrance (à faire passer Elliott Smith pour un clown !) voire rasoir sur les bords. Fouiller sa discographie de 2004 à 2010 relève tout de même de l’agréable chasse aux trésors.
Malgré (ou grâce à) une rupture de style, le premier album de Josh Tillman sous le nom de Father John Misty, l’impeccable Fear Fun (2012), trouva immédiatement son public. Beaucoup pensent alors que son passage chez Fleet Foxes est responsable de cette transfiguration. D’autres voix s’élèvent et prétendent que c’est au contraire le groupe de Seattle qui lui doit énormément. L’intéressé tranche rapidement en rendant à Robin Pecknold et les siens tout l’honneur qu’ils méritent. Déjà, il n’a participé qu’à l’enregistrement de Helplessness Blues (2011) de Fleet Foxes et avoue ne pas avoir été très impliqué dans son écriture, se contentant de jouer ses parties de batterie (et donc de s’ennuyer un peu). Lorsqu’il démissionne de Fleet Foxes, il s’excuse même auprès du public d’avoir été ce musicien réservé et distant, comme s’il voulait s’affranchir de cette facette de sa personnalité ou se libérer d’un complexe. Avec le recul, les liens de parenté entre Fleet Foxes et notre homme paraissent davantage horizontaux.
Un peu comme des cousins, ils partagent un héritage commun. Par exemple, on pense beaucoup aux Beach Boys à l’écoute de Fear Fun. Sauf que Father John Misty serait à lui seul Dennis et Brian Wilson, à la fois le rebelle désinvolte au génie tardif et le prodige laborieux aux mélodies imparables. Il en va de même si on évoque CSNY, Tillman pouvant se montrer aussi sophistiqué que Stephen Stills et aussi acerbe ou spontané que Neil Young sur une seule et même chanson de ce premier essai. Bref, la mutation fut incroyable et Fear Fun est un disque remarquable. S’il fallait chercher des poux dans la tête du nouveau Josh Tillman, tout juste signalerions-nous sa tendance à l’emphase. Il l’a avoué récemment à MTV : “J’aime vraiment pontifier.” C’est pour cela qu’il s’entend bien avec les rappeurs et particulièrement avec Kid Cudi. Comme nous, ce dernier est tombé en pâmoison en entendant Hollywood Forever Cemetery Sings, troisième plage de Fear Fun, et en a samplé le refrain langoureux. Tillman lui a non seulement accordé l’autorisation, mais il s’est pris au jeu et a enregistré quelques voix pour le troisième LP du MC de Cleveland, Indicud (2013).
Question grandiloquence, Father John Misty en rajoute une couche sur ce deuxième album, I Love You, Honeybear. Pour preuve, la scène qui s’est déroulée le 3 novembre dernier à la télévision lors du Late Show With David Letterman. En avant-première, l’Américain entonne devant les caméras son nouveau titre sarcastique Bored In The USA. Accompagné d’un ensemble de cordes et d’un orgue, Josh Tillman monte sur son piano et d’un ton sentencieux verse à sa façon quelques gouttes de vinaigre sur la dépouille du rêve américain. Mais là où Springsteen, en bon working class hero, s’engageait tout entier (du bandana aux santiags) et hurlait sa protest song à la face d’un pays peu compatissant, le jeune songwriter se montre plus précieux et distant. Plus proche d’un Randy Newman, il met en exergue le côté tragique de la situation, l’apathie des classes moyennes américaines. Cette pointe de cynisme est tempérée par une générosité certaine. Josh est issu d’une famille de protestants évangéliques. Il a été élevé au chant chrétien, il connaît aussi bien son Bob Dylan, et il s’est rendu compte que même prêchée de toute son âme, aucune chanson n’a jamais changé le monde.
Cela ne l’empêche pas de s’y consacrer entièrement. Il peaufine chaque chapitre discographique comme autant d’œuvres singulières. La cohésion ? Le fil conducteur du disque ? Disons que le bonhomme a suffisamment confiance en son charisme pour parvenir à cimenter chaque pierre (précieuse) de l’édifice. Et puis, outre les qualités de son compositeur et interprète, l’un des atouts de I Love You, Honeybear, c’est assurément Jonathan Wilson, le musicien (auteur de deux LP fantastiques sur Bella Union) et producteur résident de Laurel Canyon. Il figurait déjà au générique de Fear Fun et le voici à nouveau aux commandes de ce recueil brillant qui s’ouvre sur une paire de chansons hippie folk mélancoliques. D’abord, le titre éponyme distille à l’ensemble du disque la ferveur de ses chœurs, l’élégance des sanglots longs aux violons et la langueur monotone de la pedal steel (imaginez All Things Must Pass de George Harrison arrangé par Harry Nilsson). Puis résonne Chateau Lobby #4 (In C For Two Virgins), une sérénade en forme de ballade latine. C’est vrai, Father John Misty frôle parfois l’excès avec ce trop-plein de cordes et un maniérisme qui rappelle la variété américaine des sixties. Mais il ne tombe jamais du mauvais côté.
Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter Nothing Good Ever Happens At The Goddamn Thirsty Crow et When You’re Smiling And Astride Me (avec son break lascif aux relents de jazz orchestral). Sur True Affection, Josh Tillman se permet même de se vautrer littéralement dans la pop des années 80 avec roulements de toms électroniques, voix doublées à la Tears For Fears et solo de cuivres synthétiques. Une ambiance désuète, un brin ordinaire, mais qui sied pourtant parfaitement à cette mélodie imparable. C’est le folk apaisé de I Went To The Store One Day qui referme en douceur une fascinante collection de onze gemmes. Difficile de ne pas écouter cet ultime morceau à la lueur vacillante de Storytone (2014), le dernier album vain et stérile de Neil Young. Dans ces pages, Josh Tillman confie qu’il a dû se résigner à ne pas pouvoir être le Loner pour enfin devenir lui-même. La réciproque est vraie : le vieux Neil ne peut pas être Father John Misty. Malgré ses disparités, I Love You, Honeybear est donc une œuvre généreuse et cohérente. Son auteur refuse de se cantonner à une seule expression stylistique et c’est tant mieux. Il repousse ainsi les limites du folk en jouant avec la variété, la pop, le jazz et bien entendu le rock seventies. Josh Tillman cherche encore sa voie au travers de ses chansons, mais seul le chemin compte, pas la destination. Cet aphorisme calibré pour un mauvais film de kung-fu n’a jamais semblé aussi approprié qu’ici. Alors prions pour que la route soit encore longue.