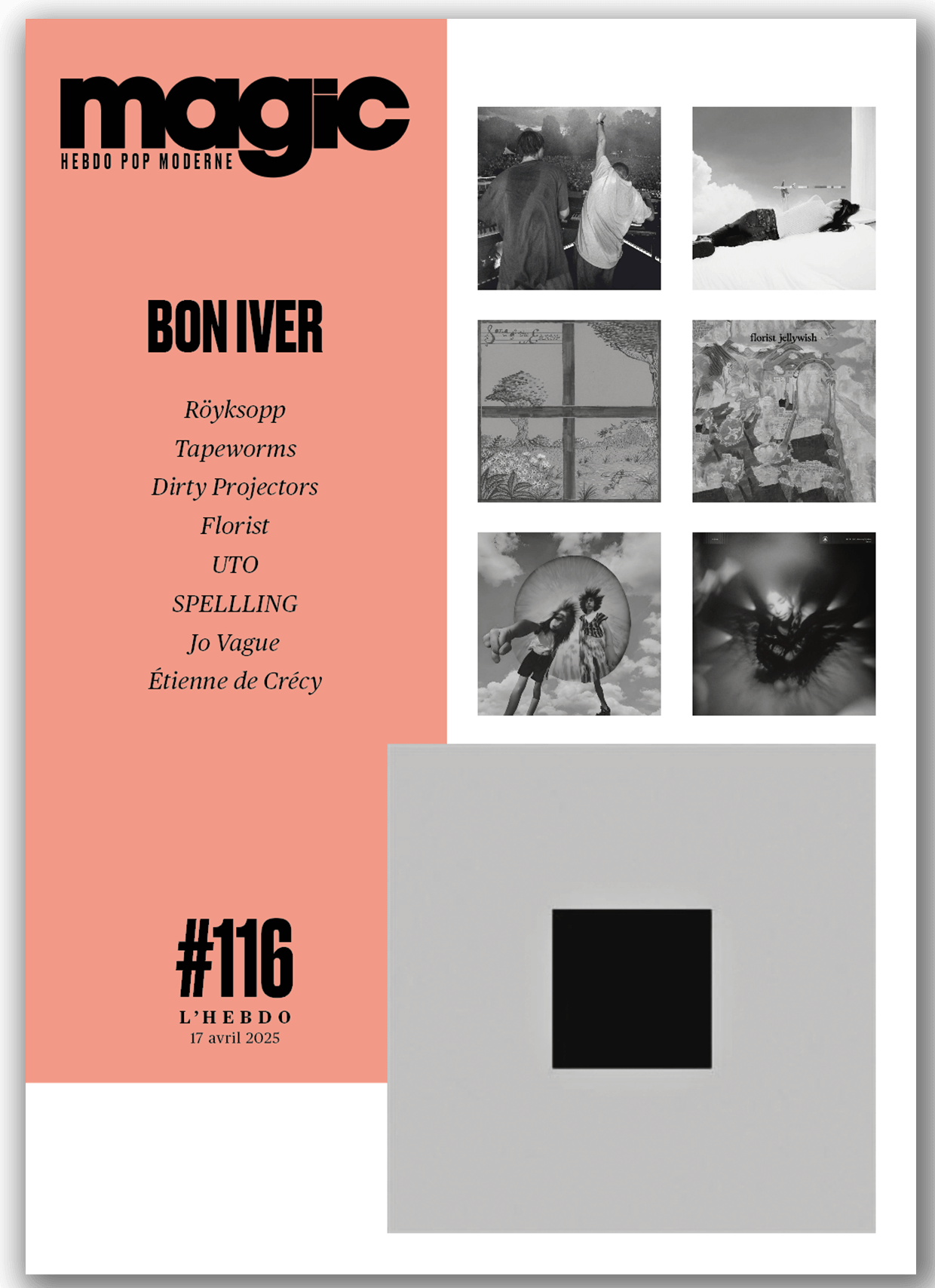“Catch a boat to England baby/Maybe to Spain/Wherever I’ve gone/Wherever I’ve been and gone/The blues are all the same”. C’est en réécoutant les premiers vers de son classique Blues Run The Game et en lisant une fois encore l’invraisemblable accumulation de péripéties qui forment la trame biographique désespérante de l’ancien colocataire londonien d’Art Garfunkel que l’on mesure à quel point la ligne est mince entre la répétition comique et le destin le plus tragique. Car pour élever ainsi la scoumoune au rang d’art majeur et aimanter avec une telle constance pathétique les peaux de bananes et les catastrophes, on ne recense que deux spécimens dans l’histoire contemporaine de l’humanité : Pierre Richard alias François Perrin et Jackson C. Frank. Gravement brûlé à onze ans dans l’incendie qui ravage son école, ce dernier survit pourtant, contrairement à plusieurs de ses camarades de classe, et entame sa carrière balbutiante d’auteur-compositeur au cours des sept mois de convalescence qui suivent, histoire de passer le temps durant son long séjour à l’hôpital. Près de quarante ans plus tard, au milieu des années 90, alors qu’un fan bienveillant nommé Jim Abbott vient de l’extraire des foyers pour SDF et des hôpitaux psychiatriques de New York – où il errait depuis la mort précoce de son fils –, il est éborgné par un tir perdu décoché par un gangster du voisinage. Entre ces deux dates, c’est donc le blues qui a mené le jeu, pour reprendre le titre de sa chanson la plus célèbre, reprise par Paul Simon ou Nick Drake.
Au-delà des anecdotes, du repli inexorable et de la disparition finale en 1999, ne reste donc qu’une réputation flatteuse mais pas usurpée de chanteur culte, une influence décisive exercée sur des personnalités essentielles du renouveau folk britannique des années 60, et un seul et unique album souvent réédité mais toujours aussi agréable à redécouvrir – on peut simplement regretter que ne soient pas adjointes dans cette nouvelle présentation les cinq chansons enregistrées en 1975 qui constituent les dernières traces discographiques recensées du plus malchanceux des songwriters folk. C’est en 1964 qu’il débarque à Londres, âgé de vingt-et-un ans, alors qu’il vient de toucher – suite à l’accident évoqué plus haut – l’argent de l’assurance qui le met provisoirement à l’abri du besoin quand ses premières tentatives pour s’imposer sur la scène folk de la côte est des États-Unis n’ont pas abouti – quelques prestations en duo avec John Kay, futur chanteur de Steppenwolf, et une audition ratée après avoir forcé la porte d’Albert Grossman, le manager de son idole Bob Dylan, s’ajoutent alors à la longue liste des traumatismes. Abandonnant définitivement ses études de journalisme, il cherche donc refuge de l’autre côté de l’Atlantique où il séduit rapidement par son talent et sa forte personnalité tous ses confrères et consœurs britanniques qui découvrent là un auteur de tout premier plan. Bert Jansch, Linda Thompson et surtout Sandy Denny, avec laquelle il entame une brève relation amoureuse, tombent ainsi sous le charme de ces compositions hantées, à la fois fortement ancrées dans une forme très traditionnelle mais qui laissent également transparaître les échos sublimés d’une douleur et d’un mal de vivre dont il ne parviendra que trop rarement et trop brièvement à se débarrasser.
En 1965, il enregistre Jackson C. Frank sur les encouragements bienveillants de deux amis new-yorkais provisoirement installés à Londres, Art Garfunkel et Paul Simon, dont la carrière n’a pas encore explosé. Paul Simon se charge notamment de la production – minimale puisque seul Al Stewart, un autre ami prestigieux, vient de temps à autre prêter main forte à la guitare – dans les studios londoniens de CBS alors que Jackson C. Frank, terrorisé par le trac, se dissimule derrière un écran pour échapper aux quelques regards alentour. Au terme d’une seule session de trois heures, les dix titres originaux sont ainsi figés pour l’éternité. Reçu avec enthousiasme par ses pairs, largement relayé sur les ondes par le jeune fan de la première heure John Peel, le disque frappe à la fois par son dépouillement et son intensité. Formellement, il est aisé de pointer ce qui relève ici de l’esprit du temps et des conventions poétiques datées – l’hymne politique Don’t Look Back, la libre association plus ou moins improvisée de Just Like Anything. À ces rares exceptions près, les chansons possèdent une puissance évocatrice et une obscure intensité – My Name Is Carnival, repris par Tim Buckley, ou You Never Wanted Me qui tire un trait charbonneux et sans complaisance sur sa relation avec Sandy Denny. De fait, elles ne trouvent un équivalent que chez de très rares auteurs au destin également tortueux, Buckley père et Nick Drake en tête. Un succès malheureusement resté sans lendemain puisque, rongé progressivement par la dépression et saisi par l’angoisse de la page blanche, Jackson C. Frank se révèle ensuite incapable d’écrire et de se produire sur scène. De retour aux États-Unis en 1969, il traversera une brève période de tranquillité familiale avant d’entamer la seconde partie, la plus longue et la plus triste, de son existence en pente douce. Réduit à sa trame la plus essentielle, son héritage musical lui survit toujours de la plus belle des manières, entretenu par la mémoire d’anciens compagnons de route comme Roy Harper, qui lui dédia avec My Friend en 1966 la plus belle des épitaphes anticipées : “I can hear you crying/Through the mist you stumble/And when you’ve taken that last sun/We’ll watch it in the darkness”.