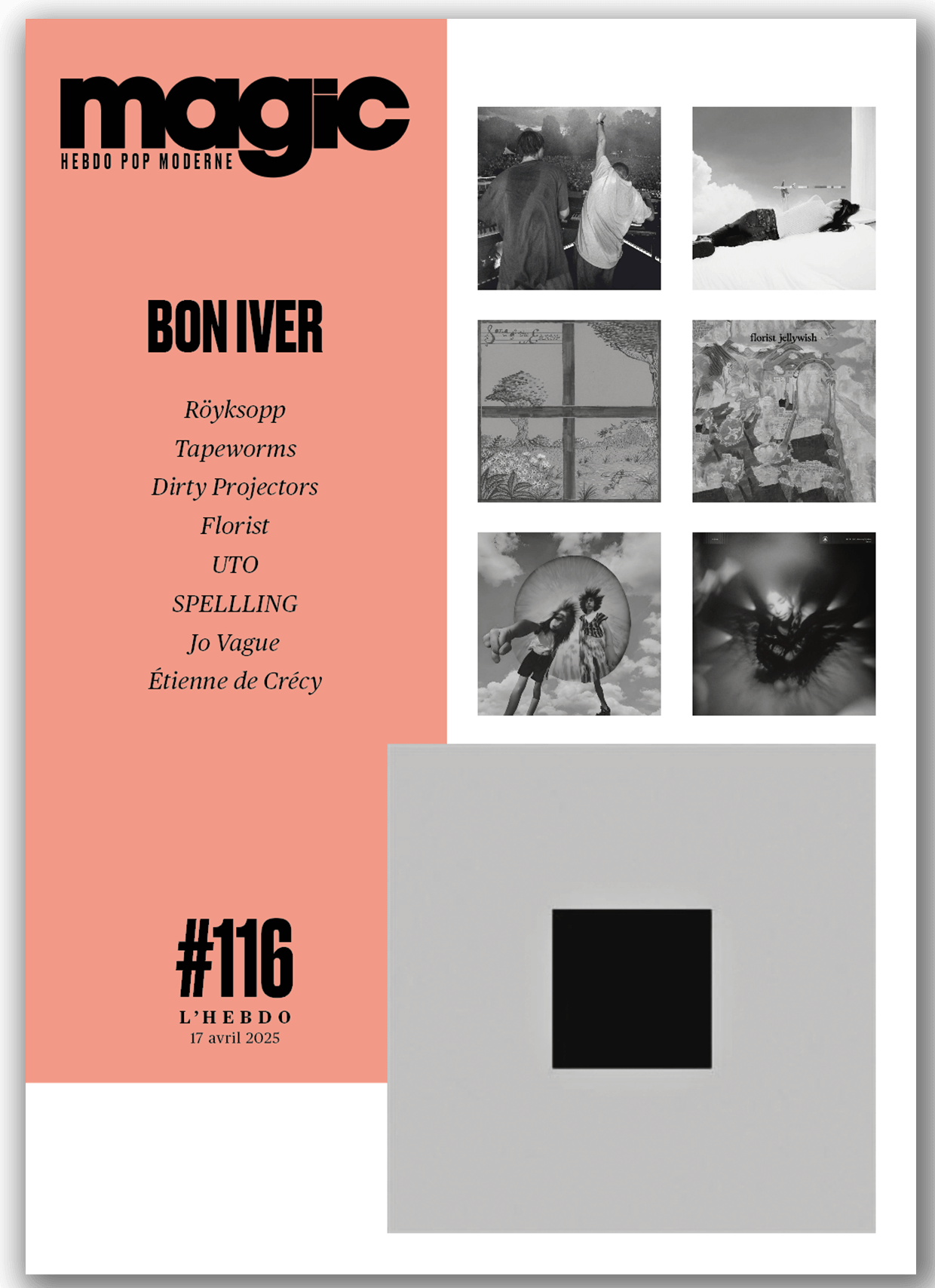Dans Le Cœur de l’Angleterre, paru jeudi 22 août chez Gallimard, Jonathan Coe retrouve les héros de Bienvenue au club et Le Cercle fermé pour un nouveau roman parsemé, comme souvent, de références et souvenirs musicaux. En janvier dernier, nous l’avions rencontré à Londres pour un entretien initialement paru dans le numéro 214 de Magic, dont le dossier de couverture était consacré au Brexit.
Les «enfants de Longbridge» vieillissent dans la Grande-Bretagne du Brexit. Jonathan Coe ne pensait pas, après Bienvenue au club (2001) et sa suite Le Cercle fermé (2004), consacrer un troisième roman à l’itinéraire de ce groupe d’amis forgé dans le Birmingham des années 1970, mais la réalité politique s’est imposée à lui. Dans Middle England, paru en novembre dernier outre-Manche et traduit en cette rentrée 2019 en France sous le titre Le Cœur de l’Angleterre, on suit ces mêmes personnages de 2010 à 2018 sur un fond musical, des gloires de la pop aux grands compositeurs classiques, qui nous rappelle une chose : être anglais, français, européen, cela s’apprend et s’interroge aussi en musique.
Dès Bienvenue au club, qui démarre en 1973, la musique façonne l’identité des personnages de la trilogie.
Votre loyauté envers une certaine musique était alors l’expression d’une identité tribale. Au lycée, si vous étiez cool, vous lisiez le NME, si vous étiez un musicien vraiment sérieux, le Melody Maker, et si comme moi, vous étiez un peu entre les deux, Sounds, que j’ai arrêté de lire quand il a viré heavy metal. Au foyer, la journée commençait par une bataille pour le contrôle de la platine. Parfois, un fan de punk débarquait et entendait un album de Yes, le jetait à travers la pièce et mettait Never Mind the Bollocks ou quelque chose du même genre. Durant les vingt années qui se sont écoulées depuis Bienvenue au club, je me suis rendu compte que cette opposition entre le punk et la musique progressive était légèrement trompeuse : le punk attaquait le rock corporate et la musique progressive était tout aussi rebelle. Je ne parle pas de groupes comme Genesis ou Yes mais plutôt de Henry Cow, Hatfield and the North ou même King Crimson, qui empruntaient des chemins très aventureux et anti-commerciaux.
Des morts de musiciens, notamment Amy Winehouse puis David Bowie, planent sur ce Middle England.
Il ne s’agit de rien d’autre que d’une coïncidence historique mais ces deuils sont survenus à des moments où l’histoire anglaise semblait prendre un virage sinistre : Amy Winehouse au moment des émeutes d’août 2011 et David Bowie au début de la campagne du référendum. Rétrospectivement, quand vous écrivez un roman, il est tentant de voir ces morts, qui ont créé un climat d’anxiété nationale, comme des pressentiments de ce qui allait se produire politiquement.
Vous consacrez aussi un chapitre à la très réussie cérémonie d’ouverture des JO de Londres en 2012. En avez-vous, comme le héros du livre Benjamin Trotter, raté le début en préférant écouter du Honegger ?
Contrairement à Benjamin, j’ai un peu changé avec l’âge mais je peux imaginer une plus jeune version de moi préférant écouter du Honegger au casque – c’est le genre de choses que je faisais pendant le Live Aid de 1985, autre moment où mon pays s’est uni autour de la musique. J’ai regardé la cérémonie chez moi, avec ma femme et mes filles, et nous avons été captivés. Je savais que mes personnages seraient heureux d’y entendre Tubular Bells de Mike Oldfield car cela confirmait leur penchant pour la musique progressive. C’est l’une des compositions les plus célèbres que ce pays a produites en un demi-siècle mais la presse musicale l’a toujours légèrement snobée.
Le lien entre musique et patriotisme semble plus fort en Grande-Bretagne qu’en France.
Vous avez déjà vu le dernier soir des Proms [1] ? Les spectateurs y sont très patriotiques mais aussi pro-européens et brandissent le drapeau européen en même temps que le britannique. Cela fait toujours polémique le lendemain dans la presse conservatrice. Donc oui, la musique a toujours pesé d’un poids idéologique plus fort dans ce pays qu’en France ou peut-être d’autres pays européens. Edward Elgar a toujours détesté les mots écrits pour son Land of Hope and Glory, bien après l’avoir composé : «Land of hope and glory, mother of the free…» Il avait l’impression que cela lui conférait une sorte de patriotisme simpliste qui n’avait jamais été dans ses intentions.
Ce chapitre sur les JO conclut la première partie, intitulée Merrie England. Un adjectif aussi utilisé par The Good, the Bad and the Queen pour son dernier album, Merrie Land.
«Merrie England» est une expression très courante, qu’on écrit merrie plutôt que merry. Elle renvoie à une époque arcadienne mythifiée dont la meilleure incarnation est peut-être le personnage de Falstaff dans les pièces Henry IV et Les Joyeuses Commères de Windsor, quand la vie était douce et la Grande-Bretagne une terre d’abondance insouciante. Dans Middle England, je l’utilise pour désigner l’Angleterre de l’avant-référendum : un endroit, dans l’esprit de certains, davantage innocent.
Vous êtes fan de l’école de Canterbury, une branche du rock progressif et psychédélique dont le nom sonne comme la quintessence de l’Angleterre.
Une partie de la musique de Canterbury sonne pas mal anglaise dans ses modes ou harmonies mais je pense que cela a davantage à voir avec un genre de caractère anglais que Benjamin Trotter représente aussi : un calme, une introversion, une ironie, le fait de ne pas faire de grands discours, patriotiques ou autres… Une sorte d’antithèse de l’Angleterre impériale qui régnait sur le monde : c’est davantage une Angleterre où les gens s’assoient autour d’un thé et discutent tranquillement entre eux. The Village Green Preservation Society pourrait presque être un album de Canterbury.
Le classique français du début du XXe siècle est aussi très présent dans vos livres. Comment l’avez-vous découvert ?
Un jour, mon père, qui avait les mêmes goûts que moi en classique, a rapporté à la maison un disque avec le Boléro de Ravel : c’est sa seule composition que je n’apprécie pas (rire), je trouve que c’est la même mélodie pendant quinze minutes. Mais sur la face B, il y avait la Pavane pour une infante défunte et j’ai trouvé cela non seulement incroyable mais sonnant un peu comme du Camel ou du Genesis sans les parties que je n’aimais pas. J’ai commencé à acheter des disques de Ravel, parfois complétés de compositions de Debussy ou Poulenc, et progressivement découvert toute cette école française.
Quand Benjamin écoute du Fauré, cette musique est qualifiée de «manifestement française». C’est quoi une musique «manifestement française» ?
Je pense qu’il faudrait avoir de meilleures connaissances techniques que les miennes pour répondre mais ma théorie est que c’est une question d’accords. Prenez le magnifique accord de septième majeure do-mi-sol-si, légèrement dissonant, triste et enjoué en même temps. Pour moi, sa première utilisation vraiment importante remonte aux Gymnopédies d’Erik Satie en 1888. De là, vous l’entendez se disséminer chez Ravel, Poulenc… Quelque chose qui m’a toujours fasciné, c’est que Vaughan Williams, pour beaucoup le compositeur anglais par excellence, a étudié l’orchestration à Paris avec Ravel : une relation sur laquelle je devrais écrire un roman ! Sa Pastoral Symphony, qui sonne comme la composition la plus paisible et anglaise qu’on puisse imaginer, a été en réalité inspirée par son expérience de conducteur d’ambulance en France pendant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de points de rencontre entre les musiques classiques française et anglaise.
Deux compositions de ce socialiste convaincu, la Norfolk Rhapsody No. 1 in E minor (1906) et The Lark Ascending (1920), reviennent sans cesse dans la trilogie, où elles sont appréciées par des personnages aux idées très dissemblables…
La Norfolk Rhapsody No. 1 est basée sur une chanson folk traditionnelle aux paroles très dures sur un capitaine de navire qui embarque un jeune garçon à bord, le punit sauvagement et finit par le battre à mort. Elle me semble raconter, dans son mélange de brutalité et de regret, quelque chose de l’identité anglaise et de la cruauté physique sur laquelle a été bâti l’Empire, dont nous nous excusons aujourd’hui. Je pense comme beaucoup que nous avons manqué d’un patriotisme de gauche en Grande-Bretagne ces dernières décennies : or l’identité anglaise, ce n’est pas seulement l’Empire, c’est aussi le socialisme, la création des syndicats… Vaughan Williams représente cela pour moi et cela m’a toujours ennuyé de voir les conservateurs en faire un des leurs au prétexte que sa musique sonne tellement anglaise.
Adieu to Old England (1974), de la chanteuse folk Shirley Collins, joue aussi un rôle central dans Middle England.
Shirley Collins est là depuis les très beaux disques enregistrés dans les années soixante avec sa sœur Dolly à l’orgue mais n’est pas très connue en dehors des amateurs de folk. Elle a une voix inhabituelle qu’une nouvelle fois je décrirais comme très anglaise, sans savoir exactement ce que cela recouvre… Ce léger accent de l’est de l’Angleterre. Dès que j’ai entendu Adieu to Old England, j’ai trouvé la mélodie incroyablement belle et l’ai gardée dans un coin de ma tête pour l’utiliser un jour. Dans ce roman, elle constitue l’expression parfaite des sentiments de Benjamin, nostalgique d’une Angleterre de tolérance et de bienveillance dont il pense qu’elle a été détruite par les résultats du référendum.
En 1990, vous ouvriez chaque chapitre des Nains de la mort, votre troisième roman, par une citation des Smiths.
Il y avait quelque chose de si particulier dans les paroles de Morrissey dans les années quatre-vingt, dans sa façon brillante d’exprimer la souffrance d’une façon humoristique et ironique. Cela m’attirait vraiment et me semblait coller au ton du livre, dont je ne pense plus beaucoup de bien mais qui restait une tentative de roman comique sur le mal de vivre et la déception amoureuse, dont Morrissey est un formidable portraitiste.
Êtes-vous déçu par son évolution politique ?
Oui, je le suis. Ce n’est pas une petite distance qu’il a parcourue, le parti qu’il soutient aujourd’hui [2] est très extrême, plus que l’UKIP. C’est comme de soutenir le National Front dans les années 1970. Des gens ont aussi pointé ces vieilles interviews où il clamait sa haine du reggae ou affirmait qu’il n’était pas invité à Top of the Pops parce qu’il fallait être noir pour ça, et vous vous dites qu’il le pensait peut-être vraiment [3]. Pour moi, cela jette une ombre même sur ses meilleurs textes pour les Smiths et je ne les écoute plus avec le même plaisir.
Un de vos héros, Robert Wyatt, vous a un jour confié en interview son dégoût d’un «sentiment anglais totalitaire»…
Il déteste cela et aussi qu’on lui dise que sa musique sonne très anglaise, ce qui est le cas. Il est l’exemple typique du musicien anglais internationaliste, comme Vaughan Williams l’était. J’aime ces deux aspects, le fait qu’il fasse partie de la scène de Canterbury mais soit en même temps un des musiciens anglais les plus ouverts aux influences étrangères. Rock Bottom reste un grand album, j’aime Shleep, Dondestan ou Nothing Can Stop Us, un de mes disques préférés du début des années 1980 avec sa belle reprise de Chic.
Durant cette décennie, vous étiez membre d’un groupe pop, The Peer Group. Est-il vrai que vous aviez essayé de signer sur Él Records ?
Nous avions envoyé une démo à Cherry Red parce que c’était la maison de disques de Everything but the Girl, dont nous étions tous fans. La cassette a dû arriver à la place sur le bureau de Mike Alway, qui dirigeait Él, une filiale du label. Je ne pense pas qu’il l’a vraiment appréciée mais quelque chose a dû l’intéresser parce qu’il nous a envoyé un gros colis de disques, dont du Louis Philippe, du Marden Hill, du Anthony Adverse… Je trouvais qu’ils avaient quelque chose en commun avec des groupes comme Aztec Camera et Prefab Sprout mais poussaient les choses plus loin. Les pochettes de disques affichaient cette sensibilité pop un peu camp, très anglaise, avec des références à des séries télé obscures des sixties. Ce genre de choses allait très à contre-courant de ce qui se passait dans la pop mainstream de l’époque et cela m’attirait.
En 2001, vous avez finalement sorti, sur le label français Tricatel, 9th & 13th, un disque enregistré avec Louis Philippe et le claviériste Danny Manners.
Nous avons donné un concert à la Maroquinerie à Paris en présence de Bertrand Burgalat, qui a entendu une de nos compositions baptisée 9th & 13th et a voulu la sortir sur Tricatel, où il avait déjà publié un disque de Michel Houellebecq – je ne l’ai jamais rencontré mais il est amusant que nous ayons enregistré pour le même label, il a un gros lectorat ici aussi… Le morceau faisait quinze minutes, donc nous avons créé trente minutes de musique supplémentaires en assemblant notamment des extraits de mes livres avec des instrumentaux enregistrés au fil des années.
L’amusant, c’est que Él est un label très anglais mais aussi très international dans son esprit, et a été l’une des grandes inspirations de Tricatel.
Vous savez, le caractère anglais que j’aime est en partie européen. Ce qui est si fou avec le Brexit, c’est que je ne vois pas de distinction tranchée entre le fait d’être anglais et européen. En ce qui me concerne, nous sommes européens mais apparemment d’autres ne sont pas d’accord.