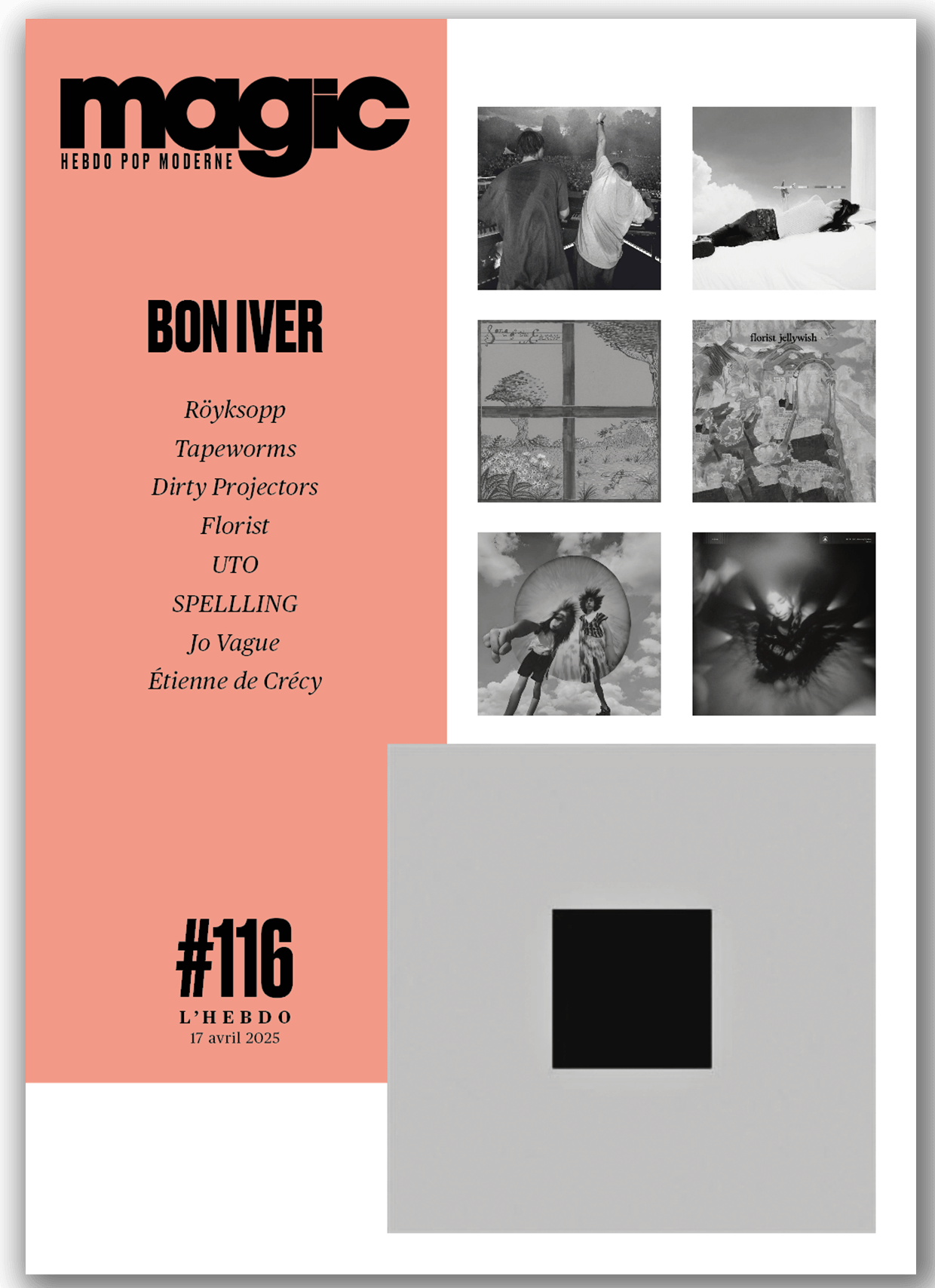Jusqu’à présent, le parcours de Motorama ressemble à un cas d’école pour qui souhaite analyser le fonctionnement des leviers médiatiques. Passé sous à peu près tous les radars établis (pas celui du blog de magic) à la sortie de son premier album autoproduit et offert en téléchargement gratuit sur son site (Alps, 2010), le quintette russe s’est retrouvé bombardé d’attentions lorsque le label bordelais Talitres eut l’excellente idée de signer le LP suivant, Calendar (2012). Deux (presque) chefs-d’œuvre, tenant esthétiquement dans un mouchoir de poche ; l’un soumis aux forces centrifuges, l’autre aux forces centripètes d’un champ journalistique qui carbure encore et toujours à l’imitation malgré l’éclatement des scènes et la multiplication des sources (comme pour se dédouaner d’un labeur impossible). Tant pis, puis tant mieux pour ce groupe pop moderne dont on connaît désormais par cœur les principaux signes distinctifs pour les avoir vus recensés dans tant d’articles et d’interviews.
L’origine de Rostov-sur-le-Don, capitale russe du hip hop où ces grands romantiques n’ont pas leur place ; le nom piqué sans trop y réfléchir à une drôle de comédie américaine où figurait une Drew Barrymore à peine pubère (Motorama, 1991) ; l’obsession pour le post-punk mancunien de Factory Records (Joy Division, The Wake, Stockholm Monsters), la twee pop circa C86 et la jangle pop australienne de Flying Nun Records (The Verlaines, The Chills, The Clean) ; la tendance farouche au DIY (enregistrements en autarcie, visuels artisanaux) et à une posture anti-carriériste qui se moque des fuites et assume la nécessité de boulots alimentaires ; le goût pour une certaine littérature classique, d’Ivan Bounine à Herman Melville en passant par Guillaume Apollinaire et Samuel Johnson. Tous ces repères se trouvent immédiatement réactivés au moment d’écouter et de juger ce nouvel essai joliment nommé Poverty. Un disque qui sera sans doute largement considéré sous l’angle du passage de cap, confirmant ou infirmant les espoirs placés en eux à la sortie de Calendar – comme s’il s’agissait d’un deuxième LP, Alps n’ayant pas été validé comme objet saillant par ceux qui l’ont manqué. Essayons donc, en amont d’un emballement qui pourrait bien ne jamais arriver, de le considérer à sa juste place dans l’œuvre de Motorama.
C’est-à-dire comme le nouveau – et meilleur – chapitre d’une aventure aux codes déjà établis, aussi profondément référencée (voir plus haut) qu’immédiatement identifiable – donc personnelle. Cela semble d’autant plus pertinent que, à l’inverse de beaucoup de leurs contemporains, Motorama se fiche royalement de provoquer le moindre effet de rupture pour créer l’illusion d’une mise en danger. Sur le plan matériel, Poverty a une fois de plus été enregistré en une semaine dans l’appartement du chanteur Vladislav Parshin, puis mixé en compagnie du guitariste Maksim Polivanov. Toujours pas de producteur en vue pour court-circuiter leur autonomie, donc. Celle-ci se trouve renforcée par l’acquisition d’un studio portable 16-pistes (il faut bien que l’embryon de succès soit mis à profit), offrant à leur son une limpidité et une prestance encore plus frappantes qu’à l’accoutumée. Côté références, leur catalogue intime s’est étoffé en lorgnant du côté de l’americana gothique (on pense un peu plus fort à The National dans le chant viril et lancinant de Vlad et la basse profonde de sa compagne Airin Marchenko), tandis que les textes porteraient selon leur auteur la marque de la poétesse du poète russe Ilya Kormiltsev. Plus encore, c’est la maîtrise instrumentale dans son ensemble qui prend ici aux tripes, balayant les approximations d’hier pour offrir aux chansons l’ampleur qu’elles ont toujours méritée.
Débutant comme un inédit de The Church délesté de l’emphase eighties, Corona trace avec souplesse et nonchalance la ligne claire qui servira de référence esthétique pour la suite. Contrairement à celle d’un Mac DeMarco, la guitare carillonne sans en faire un programme explicite alors qu’un clavier minuscule égrène un motif d’une ravissante simplicité. Dispersed Energy démarre sur le même rythme, mené par une basse qui ne s’interdit pas de rappeler Joy Division, et glissant dans une torpeur nocturne et classieuse. Place à un Red Drop aussi pointilliste que son intitulé peut le suggérer, parcouru de vaguelettes scintillantes où le chant se laisse tendrement dériver, tout comme Heavy Wave, dont l’interprétation apaisée évoque un Luna à quai dans un port du Vieux Continent.
Un peu plus loin, Lottery s’accroche à une pulsation métronomique (apparemment produite sur une boîte à rythmes mais néanmoins chichement humaine) comme à cette guitare rythmique plus rêche qui renvoie aux débuts du groupe voire aux jeunes The Cure de Three Imaginary Boys (1979). Suit Old, l’un de ces morceaux (paradoxalement) indatables dont Motorama a le secret, puis Similar Way, dont la batterie rebondissante ouvre aux autres instruments (voix comprise) un espace d’expression décuplé où la moindre aspérité fait sens – génie du less is more qui s’applique à l’ensemble de leur œuvre. Le moment est venu de lâcher l’ultime merveille de Poverty. Grâce à son beat d’obédience “new orderienne” et sa mélodie répétitive et butée (basse, chant et clavier serrés dans un baiser collectif), Write To Me provoque en moins de quatre minutes une sorte de transe moite, comme issue de la zone temporaire entre rêve et réveil. Ainsi, une demi-heure suffit à Motorama pour faire oublier la concurrence, prouvant que l’acceptation de la pauvreté est la seule manière d’arracher toutes ces belles (et désormais consensuelles) références aux pesanteurs de la temporalité.