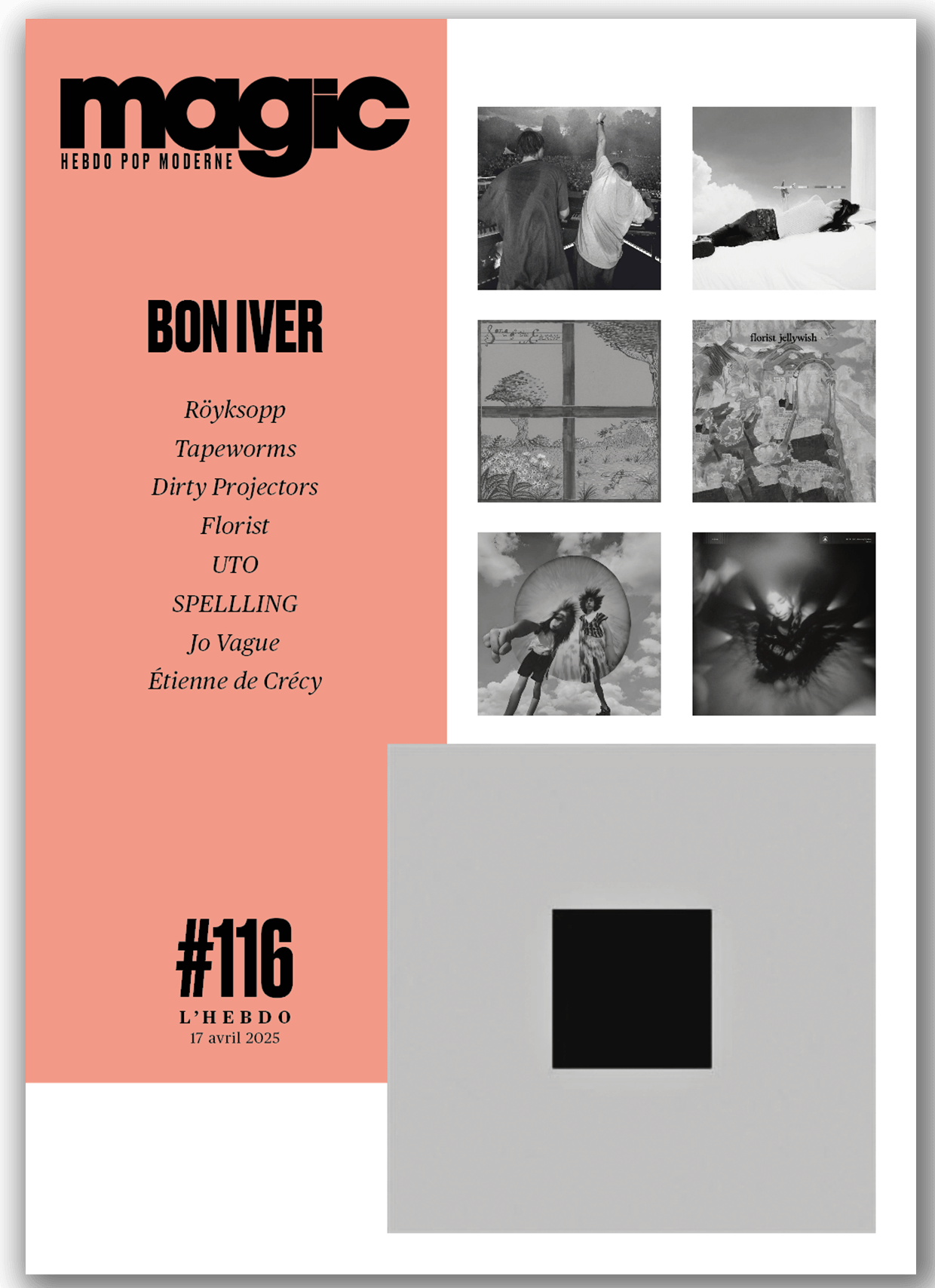Il est des chefs-d’œuvre immuables dont on sait qu’ils resteront à jamais dans notre panthéon personnel. La plupart ont en commun une bien étrange particularité : on ne les a pas compris à la première écoute ; le flash, le satori, l’illumination ne se sont pas faits en un jour, ni du premier coup. Or si certains disques entrent et sortent de notre quotidien au gré des envies, des humeurs, des (re)découvertes et parfois même des surprises, on peut sans peine affirmer que Spiderland de Slint a toujours tenu une place indétrônable dans notre Top 5 depuis sa sortie en mars 1991, soit vingt-trois ans d’intimité. Et nous ne sommes apparemment pas les seuls. Qui aurait cru qu’un album enregistré en quatre jours et quatre nuits, ne comprenant que six morceaux, édité sans battage médiatique par quatre Américains à peine sortis de l’adolescence et dont le groupe se séparera avant même sa sortie, allait devenir un tel emplâtre générationnel ? Spiderland a été discuté, analysé, débattu, mis à toutes les sauces. Sa descendance remplirait à elle seule plusieurs bacs de disquaires et selon l’expression consacrée, un bottin n’y suffirait pas. Comme le premier album de The Velvet Underground, il ne fit que peu de bruit à sa parution – seul Steve Albini cria au génie absolu dans une critique du Melody Maker devenue depuis légendaire. Mais le disque continuera à se vendre avec une régularité étonnante. La présence du morceau Good Morning, Captain dans la bande originale du film Kids (1995) de Larry Clark (par ailleurs essentiellement composée par Lou Barlow et John Davis sous l’alias The Folk Implosion) y contribuera pour beaucoup. Le fait qu’il ressorte aujourd’hui dans une version luxueuse, remasterisée par Bob Weston (Shellac), comprenant quelques inédits et autres versions de travail, dans un coffret avec vinyle et CD, le tout agrémenté d’un formidable livre d’images, arrive à point nommé. Car on en avait presque oublié à quel point Spiderland était fantastique. Le (re)découvrir à l’occasion de cette exhaustive mise en boîte permet d’en apprécier à nouveau et rétrospectivement tout le sublime.
Longtemps, on ne sut rien ou presque de Spiderland, et c’était très bien ainsi. Rien, hormis le nom du type qui prit la photo de la pochette (un certain Will Oldham, un ami de la famille) et la vaine annonce de recrutement d’une chanteuse qui figure au verso (Interested female vocalists write 1864 Douglas Blvd, Louisville, Ky. 40205”). La légende voudrait qu’une certaine Polly Jean Harvey y répondit. Cette même légende s’éclaircit enfin grâce au DVD de l’excellent documentaire Breadcrumb Trail réalisé par Lance Bangs, fan de la première heure, par ailleurs collaborateur de Spike Jonze et des séries Jackass et Portlandia. Un vrai travail de fond mené depuis des années et égayé par les témoignages de Steve Albini, James Murphy, Matt Sweeney ou David Grubbs. Si ce document lève le voile sur l’histoire de Slint et la conception de l’album de manière assez complète, il ne permet toujours pas de comprendre tout à fait ce qui a présidé au mystère de son élaboration. Après visionnage, on sait enfin à peu près tout, c’est-à-dire quasiment rien. C’est dire l’insondable nébuleuse que représentera toujours le second LP de Slint dans la cartographie d’un rock américain qu’il a pourtant emmené ailleurs. Pierre angulaire du post-rock certes, mais rappelons à toutes fins utiles que le terme ne fut utilisé que deux ans plus tard par le critique Simon Reynolds à propos d’un autre chef-d’œuvre certifié, Hex (1994) de Bark Psychosis. Alors, si le terme colle aux basques de Spiderland, on peut lui préférer celui de post-hardcore, ce punk rock ultra rapide de l’Union, puisque c’est bien de là que viennent Britt Walford, Brian McMahan, David Pajo et Todd Brashear, tous génies précoces au sein de Squirrel Bait ou Maurice. Slint se forme véritablement en 1986, enregistre l’inaugural Tweez sous la bienveillance de Steve Albini l’année suivante, mais ne le sortira qu’en 1989, quasiment à compte d’auteur. Si on y trouve déjà quelques formulations qui éclateront par la suite, on a du mal à imaginer comment un tel paquet de nerfs va donner à entendre autant de beauté maladive. Chant parlé/hurlé/chanté, distorsion maîtrisée, tension contenue, science de l’arpège en descente/ascension, tout est déjà là, mais en jachère.
On ne sort pas indemne de Spiderland, ça ne rigole plus, l’inquiétude reprend le dessus sur la fougue de la jeunesse. Elle ne vous lâchera plus jamais, mais elle est paradoxalement porteuse des plus grands espoirs – que Slint ne concrétisera jamais, l’un d’eux finissant même en maison de repos avant la fin de l’enregistrement. Comment à peine adultes, quatre garçons ont-ils pu produire une musique aussi sombre, aussi riche, mature, raffinée et presque inédite sous cette forme-là ? L’énigme ne sera jamais véritablement résolue. Et l’on envie une fois encore ceux qui poseront une oreille vierge sur ce monument qu’on glissera volontiers entre Red (1974) de King Crimson, Marquee Moon (1977) de Television et Unknown Pleasures (1979) de Joy Division, c’est-à-dire dans cette noble lignée des disques à guitares (et basses) à la fois aériennes et poétiques, mais sales et tendues comme des arcs vers les plus hautes sphères. Il faudrait un volume entier pour décrire encore ce que Britt Walford, grand architecte et véritable mentor de Slint, fait subir à sa batterie. Et si finalement Spiderland était, selon cette théorie un brin absurde, un assassinat en bonne et due forme ? Et peut-être plus encore que Loveless (1991) de My Bloody Valentine ou même Nevermind (1991) de Nirvana, autres marqueurs générationnels de taille, le dernier disque de rock à guitares ? Que faire alors après avoir été les acteurs ou les témoins d’un crime pareil ? Garder le silence, sceller un pacte, comme les gamins dans Stand By Me (1986) de Rob Reiner, Mystic River (2003) de Clint Eastwood, ou les filles de Shokuzai (2013) de Kiyoshi Kurosawa. Deux ans plus tard, les musiciens de Slint se retrouveront pour aider le photographe de la pochette (Will Oldham, donc) à enregistrer le premier album de Palace Brothers, There Is No-One What Will Take Care Of You (1993). Un disque qui fit beaucoup pour la dépénalisation de la country pour les personnes de notre génération, la remit au goût du jour, même sous une forme un peu rustre, voire vicieuse. Comme si les membres de Slint, après avoir dynamité le hardcore, revenaient inévitablement à la terre, scellant ainsi dans un grand geste fraternel leur contribution aux grands enregistrements du XXe siècle d’une Amérique en mal d’humanisme.